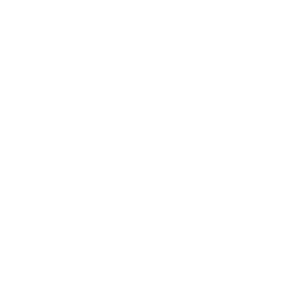Textes de l’atelier biographique. 1/3
(Session février-mars 2024)
Si un atelier d’écriture de Marie-Joelle m’était conté… par Karima Moudoub
Comment retranscrire avec justesse, cette expérience à peine achevée, du mardi 12 mars 2024 ? La première rencontre à l’ACB avec Marie-Joëlle Rupp remonte au 30 janvier 2024 et s’ouvre sur une citation d’Edouard Glissant, penseur, philosophe martiniquais dont j’entends le nom et les mots pour la première fois, pour inscrire la dimension de l’écriture biographique et autobiographique dans un atelier qui comportera en tout 6 à 7 séances : « l’oubli offense et la mémoire quand elle est partagée abolit cette offense. Nous devons nous souvenir ensemble » (Une nouvelle région du monde, Gallimard, 2006). A partir de cette phrase, la constante application de Marie-Joëlle à partager ses techniques d’écriture ont fait de moi une élève appliquée, d’autant que lors de la première séance, je découvre avec une satisfaction joyeuse que j’écris déjà – je suis diariste ! – j’écris dans des journaux intimes depuis l’adolescence et je m’exerce donc à l’écriture. Je sais écrire !
Il est délicieux d’écouter, de lire et d’apprendre l’Algérie, la Kabylie et l’universalité du pouvoir de l’écrit au travers des témoignages recueillis par Marie-Joelle, soit dans son travail journalistique, soit dans les portraits et biographies qu’elle a écrits, captivée et captivante, pour retracer ces mémoires individuelles oubliées de la grande histoire.
Autre temps fort, celui de la projection d’« Une Journée au Soleil ». Ce film et les interviews des témoins qui se sont succédés m’ont transporté et m’ont permis de recoller quelques morceaux épars de la mémoire de feu mon papa et donc de l’histoire de la famille Moudoub, en partie la mienne, au croisement de l’histoire d’amour et de haine France-Algérie. Une histoire bouleversante, de résistance, de quête de démocratie. Je ressens l’hospitalité de Saïd, le patron du café Le Soleil, un homme à la force tranquille, au visage bonhomme, le béret sur la tête et la moustache fière qui accueille à l’intérieur ou sur la terrasse, chacun de ses clients comme s’il était un membre de sa famille. Il est cet homme libre, philosophe dans ses propos du quotidien.
J’apprends le rôle du café dans l’exil des Kabyles et je pense à mon père qui aurait possédé en copropriété, semble-t-il, un ou deux cafés à Lyon, Place du Pont. Je ne pense pas avoir les moyens de le vérifier. J’apprends que le café est un lieu qui recrée le village et ses rites, ses obligations. On a la possibilité d’y manger, parler, écouter de la musique. On pouvait également, avant ma naissance, y exercer une action sociale et politique en faveur du pays d’origine.Quand j’entends et découvre le visage et les mots de Dehbia, le seul visage féminin de ces témoignages d’un temps que je n’ai pas connu, je découvre la mémoire de la guerre de libération algérienne et la dimension politique et résistante du café. Cette guerre a eu lieu en France dans une extension de l’Algérie française et je pense que mon père faisait partie de cette action patriotique, volontaire ou contraint, le FLN et le MNA ne laissant guère de choix aux travailleurs en exil. Ces cafés étaient le théâtre de batailles auxquelles se livraient les deux partis nationalistes, le lieu des règlements de comptes et des passages à tabac entre immigrés et forces de police.
J’ai eu une immense admiration pour le sens de la communauté de mon père et je l’ai imaginé pour la première fois aux heures de ses premiers pas en France, se réchauffant dans un café kabyle à l’image du Soleil, mais à Lyon où il a pu écouter peut-être un concert d’Aït Menguellet qu’il aimait tant ou d’autres artistes, – va savoir !- auxquels il pouvait encore s’identifier au temps de sa jeunesse. Il est arrivé en France à 18 ans à peine pour y travailler comme un forcené. Il y aura peut-être aussi dîné d’une chorba, ou pas…, avant d’épouser ma maman. Mais surtout, il aura compensé l’absence et l’isolement dans un pays où même exilé, il restait soumis au Code de l’indigénat, et où il a peaufiné son identité au milieu de ses pairs, tous kabyles.
Le café, hormis pour Dehbia qui y est quasiment née, est un village réservé aux travailleurs, des hommes résistants pour la plupart. C’est pour moi une découverte incroyable. Les cafés sont aux Algériens le lieu de résistance politique qu’étaient les églises pour les Corses ou d’autres quand les réunions politiques étaient interdites. En plus des techniques d’écriture, j’ai ouvert lors de cette aventure, un regard nouveau sur l’Algérie, cette ancienne colonie française et compris pourquoi j’ai toujours ressenti plus jeune du mépris pour mes parents de la part de certains français. L’apartheid a laissé ses marques. Le Code de l’indigénat a laissé des traces d’un passé qui n’est pas si lointain.
Merci Marie Jo, merci l’ACB, merci Saliha et Hassina.
Portrait de la mère
Ouardia O Moussa vêtue de blanc, sourit de toutes ses dents. Aujourd’hui est un jour grand. Elle marie l’un de ses enfants, l’un de ses fils cadets, Dalile. Elle irradie de bonheur. Elle tient sa main dans la sienne, maman, dans son meilleur rôle, le sien, maman.Son visage émacié est jeune encore en ce début d’octobre 1999, le 9 exactement. Sa tête est ceinte d’un foulard blanc, ses bras couverts de manches longues, une tenue en apparence modeste dont pourtant je ressens le soin qu’elle y a apporté. Coquette, maman l’est toujours, en tenue européenne ou kabyle, ses tenues de dessus ou de dessous mélangent savamment les couleurs et les textures. Au côté de son fils Dalile, encadrée par son autre fils Farid, elle est joyeuse et tranquille. Son regard souligné de khôl respire la tendresse et la délicatesse. Elle est heureuse, bienveillante.
Aujourd’hui, Maman est une femme accomplie. Elle marie son fils Dalile à Christine, dans un endroit qui ressemble à un château, juste à côté de Vienne dans l’Isère et qui s’appelle Mont Sève Roux. Le soleil brille encore en ce mois d’octobre et bien qu’elle ne soit pas dans son pays natal, la proximité des champs et ces bâtisses de vieilles pierres la ramènent à sa terre. Celle où elle a grandi et qu’elle foulait petite, enfant de la campagne et pas de la ville. Cette terre où bien que petite de taille, elle pose crânement enracinée. Le blanc de sa tenue la fait paraitre plus grande, plus lumineuse et le contraste de la couleur sombre du costume du marié et de son frère ainé accentue son aura et toute la lumière qui se dégage d’elle et de son sourire angélique. Sur cette photo, je ne vois qu’elle.
Karima Moudoub
Essai d’autobiographie
Je suis née le 7 décembre 1969… Je suis née le 7 décembre 1969 à Lyon, 4ème, à la clinique de la Croix-Rousse. L’ironie me fait naitre gone ou gonesse comme j’aime à dire car la Croix-Rousse et ses pentes sont le cœur des soyeux, ces riches Lyonnais d’antan. Lyon comme Paris comprend des arrondissements et c’est la troisième ville de France. Je suis la neuvième enfant de Mohand-Salah Moudoub et de Ouardia O’Moussa.
Mes parents, sont tous deux algériens, nés et grandis dans le même village accroché aux collines de Kabylie, Tadekent. Ma maman lui fut promise dès sa petite enfance dit la légende et mon papa aurait été le plus beau du village. Je suis la cadette de quatre filles, les quatre filles Moudoub, et j’ai grandi dans une cité tristement célèbre, pour les méfaits en tout genre qui y ont été commis. Encore aujourd’hui ce quartier de la Duchère fait parler de lui pour le commerce de la drogue.
Au château de la Duchère, j’ai appris la géographie du monde grâce à toutes les familles immigrées qui s’y sont construites en même temps que j’y ai grandi. J’ai des souvenirs confus de mon enfance familiale. Hyper sensible, hyper émotive, j’étais cajolée par ma sœur ainée Yasmine et souvent irritée par mes deux frères cadets, Dalile et Dassil, avec lesquels j’ai grandi tout en n’ayant d’yeux et d’oreilles que pour mes sœurs ainées, source d’inspiration et de connivence inépuisables.
J’aime passionnément mes frères et sœurs mais j’ai aussi été élevée dans une forme de crainte, d’appréhension de mon frère Karim avec lequel j’ai un an et demi d’écart. Je l’ai suivi de la maternelle au baccalauréat et bien que nous ayons partagé notre scolarité dans les mêmes établissements, curieusement, je n’ai aucun souvenir de vie commune avec lui. Pas même par exemple, de me rendre au collège à pied à Écully en sa compagnie, ou au lycée Jean-Perrin plus tard en autocar. Karim, Karima une seule voyelle nous sépare …
Je sais par ma maman que, peu de temps après ma naissance, mes parents m’ont emmenée en Algérie au cours de vacances d’été. J’y ai contracté une forte fièvre et j’ai failli y mourir. Mon père aurait remué ciel et terre pour me guérir à Sidi Aïch ou Alger, je ne sais, et il y serait parvenu. Sa propre mère seţţi Zineb, lui aurait dit qu’il n’y avait aucune raison de s’escrimer à me sauver, qu’il était jeune et qu’il pourrait avoir beaucoup d’autres enfants.
Karima Moudoub