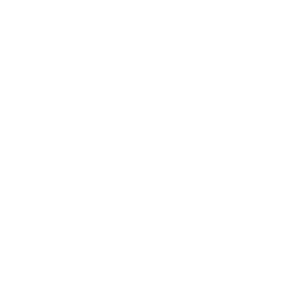L’histoire d’Idir avec l’ACB est une longue et belle histoire. Elle a commencé dès 1979 et s’est poursuivie sur près de quatre décennies. Au cours de ces années de travail, de mobilisations, d’échanges et d’amitiés, Idir a donné, en 1985, en 1999 et en 2007, aux magazines de l’ACB (Tiddukla d’abord puis Actualités et culture berbères) trois longs et importants entretiens. Ce sont ces entretiens que nous vous proposons de (re)lire pour (re)découvrir un homme d’engagements et de convictions.
3/3 – Idir dit tout
Entretien donné par Idir à l’ACB en décembre 2007
Hamid Cheriet a atteint cette stature internationale qui dispense de le présenter. Il suffit de prononcer les deux syllabes de Idir pour entendre tinter les bijoux de cette jeune femme kabyle qui demande à son père de lui ouvrir la porte de l’hiver car elle a froid et que les chacals sont à sa poursuite. C’est dans A Vava Inouva et cette chanson, qui a aujourd’hui 35 ans, n’a pas perdu un traître son de sa puissance d’évocation et d’ancrage. Depuis ce tube identitaire, Idir a fait du chemin humainement et artistiquement jusqu’à devenir un artiste de la synthèse qui arrive à réunir autour lui, et de sa musique kabyle si proche et si loin des racines kabyles, des artistes issus de tous les pays du monde, de tous les genres. Cela faisait longtemps que nous escomptions faire avec lui le point. Nous découvrons, comme on s’y attendait, un artiste encore en fusion, créatif, inventif et, derrière l’ancien étudiant en géologie, un intellectuel qui s’intéresse à la marche du monde et réfléchit à la citoyenneté, à la justice sociale, à la politique et, ce qui ne gâte rien, un artiste cultivé, curieux de musique classique et de littérature sans pour autant être coupé de cette culture matricielle qui continue à le porter et qu’il porte.
« La France des couleurs défend les couleurs de la France » ton dernier album en date est-il une façon de prendre position dans le débat français ?
IDIR : C’est d’abord une façon de m’interroger sur ma position ici, qui est celle de beaucoup d’autres. C’est aussi une façon de comprendre et de définir cette France. Comment est-elle ? Est-elle le reflet assez fidèle de celles et ceux qui la composent aujourd’hui ? Elle ne me parait pas définissable actuellement sans ces couleurs.
Dans l’album, tu invites des rappeurs, des slameurs, des artistes qui incarnent une France exclue par l’extrême droite…
IDIR : Forcément. La définition véritable de la France d’aujourd’hui, c’est un ensemble de gens qui ne font pas un peuple mais une nation. Zidane, Poniatowski, Noah, ça ne forme pas un peuple. Par contre, il y a des citoyens, des nationaux qui sont unis par un même destin, et sous le coup d’un certain nombre de droits et de devoirs et de rêves qui forment la société française. C’est loin des définitions que les gens du Front national donnent dès lors qu’ils excluent tout ce qui ne leur ressemble pas. Disons que c’est une antithèse de ce que prône le Front national.
Te sens-tu interpellé par le débat en France ?
IDIR : J’y vis, forcément. Même si je suis Algérien de nationalité, il y a des réalités auxquelles je suis confronté parce que j’y travaille, j’y paie des impôts. Je suis donc redevable et on me doit des explications, des positions, des clarifications sur certaines choses, tout en observant un devoir de réserve, parce que tenu, en temps qu’étranger, de ne pas trop m’immiscer dans les affaires internes de la France.
Ressens-tu des sympathies politiques ou humaines dans l’échiquier politique français ?
IDIR : Nous vivons une époque un peu bizarre où la droite n’a plus le monopole de l’argent ni la gauche celui de l’humanisme. Nous assistons à la fin de cette gauche qui te demandait de brandir des petits drapeaux le dimanche, image qui nous rappelle les caricatures droitières. Au même moment, voilà un président de droite ratissant large à gauche, qui évoque Guy Moquet, Léon Blum ou Jean Jaurès. A chaque fois qu’il y a une élection présidentielle en France, on a l’impression de voter moins pour une orientation politique que pour un homme. C’est toujours la valeur des hommes, leur hauteur, leur charisme, qui transcende les partis auxquels ils appartiennent. Il n’en demeure pas moins deux projets de société qui sont bien distincts : celui du capitalisme effréné et le projet de ceux qui essaient de réfléchir à une redistribution des richesses en nivelant les choses par le haut.
Lequel de ces projets te paraît le plus proche ?
IDIR : Idéalement, il n’y a pas mieux que la thèse communiste, mais cela reste seulement un idéal. La position la moins mauvaise possible, c’est d’être ancré à gauche. L’autre côté prédispose à des dangers éventuels.
Des ministres d’origine maghrébine, est-ce aussi cela la France des couleurs ?
IDIR : Oui, je le pense. Ceci dit, ce n’est pas le gouvernement qui a fait ces choix. C’est le choix d’un homme qui fait preuve d’une audace extraordinaire. Il va au-delà de ses propres convictions et parfois à contre-courant de ses administrés, ce qu’il fit lorsqu’il était président de FUMP. C’est quelqu’un qui ose, et qui veut se ranger dans les catégories des grands hommes tels que De Gaulle, Mitterrand, Churchill… Avec ces actes-là, on a l’impression qu’il n’y a plus de clivage entre la gauche et la droite. Nommer quelqu’un de chez nous par exemple, à un poste ministériel comme celui de la justice, chapeau ! Parce qu’il faut voir où en est le conservatisme… Ce que la gauche n’a jamais pu ou eu le courage de faire, il l’a fait. Ce qui m’intéresse chez cet homme, c’est son audace, et jusqu’où il peut aller dans cet esprit audacieux.
N’est-ce pas de la tactique politicienne ?
IDIR : Tactique ou pas, peu importe, il l’a fait ! Il a ratissé large, il a fait appel à des socialistes, certains ont dit oui, d’autres non, il a essayé. Seul le temps nous dira si c’est une tactique ou un subterfuge. Entre temps, il fait des choses qu’aucun autre n’a jusqu’à présent osé. Ceci dit, je n’aurai pas voté pour lui.
Revenons à la musique, à ton dernier album. Toi qui es un musicien puisant son inspiration à la source de la musique traditionnelle kabyle, comment le besoin s’est fait-il sentir d’aller à la rencontre d’autres musiques plus urbaines, telle que le rap, le slam, etc. ? Qu’est-ce qui motive artistiquement cette démarche ?
IDIR : C’est exactement ce qui motive ta propre démarche, toi, de Beni Yenni, venu sur Alger rencontrer l’Autre. L’essentiel est de vous enrichir mutuellement à partir de vos différences respectives. L’essentiel est aussi l’envie de découvrir d’autres horizons que ta propre culture ignore. Ton identité se remet en question chaque matin que Dieu fait. Et chaque matin, tu es un homme nouveau, en quête d’autres choses. Tu as tes propres interrogations et, à partir de celles-ci, tu te forges une personnalité artistique qui se démarque de ta personnalité d’origine. Au départ, nous pensions que la culture du monde s’arrêtait à la porte de notre village. Il suffisait de sortir de celui-ci pour tomber sur les autres qui existent, qui ont le mérite d’exister, qui ne sont nés ni pires ni meilleurs. A partir de ce constat, tu fais des comparaisons et tu t’enrichis. Au fil des années, tu as envie d’interpréter au plus juste le monde dans lequel tu vis.
Quand on voit ce que tu as produit ces dernières années, on comprend bien que tu es assez attiré par les musiques un peu marginales ou plus exactement marginalisées. Je pense à ce que tu as fait avec des musiciens bretons, par exemple, et aussi avec les artistes de la nouvelle génération issus du rap. Cela ne traduit-il pas un ancien réflexe d’homme issu des « minorités » ?
IDIR : C’est possible. Je suis toujours un minoritaire, de toutes les façons. Ici où là-bas, j’appartiens à une communauté minoritaire. Ici, je suis en tant que Kabyle minoré dans une communauté déjà minoritaire. Je suis également un petit peu mis à l’écart tant au niveau de ma culture et de son expression dans mon propre pays. Je le suis par mes orientations politiques et pour un certain nombre d’autres raisons. Étant minoritaire, on ressent l’envie de sortir de cette minorité et ainsi que celle d’exister avec nos différences. Le seul moyen que j’ai trouvé pour m’en sortir, c’est de partager avec l’Autre, minoritaire ou pas. Pourquoi des Bretons, pourquoi des Écossais ? Je sens que la notion d’origine et d’identité est également très forte chez eux. Ils ont encore les mains agrippées à la terre à laquelle ils sont bien ancrés. Cela me permet aussi de tenir ma position, de pouvoir la défendre. C’est une première chose. Deuxièmement, je le fais parce que je veux montrer que ma culture, mon identité aussi minoritaire soit-elle, peut s’inscrire avec les autres à égalité, et que, de l’autre côté, il y a une reconnaissance implicite de ce que je suis lors que des gens plus proches de moi le font très difficilement. C’est un besoin de vivre qui m’amène à partager et vivre avec les autres.
Si j’ai bien compris, tu as mis très longtemps avant de vouloir chanter en français ! Il y avait un blocage dont je ne connais pas les raisons… Aujourd’hui, tu as l’air d’avoir complètement dédramatisé ! Que s’est-il passé ?
IDIR : C’était plus qu’un simple blocage, c’était tout simplement un refus. Le français est une langue que j’ai acquis empiriquement. Ce n’est pas ma langue maternelle, je n’avais aucune raison de chanter en français. J’étais un Kabyle qui avait des revendications à exprimer dans sa langue maternelle, c’était suffisant. J’aurai pu chanter Fatima ou Aïcha pour essayer de ratisser large. Les gens de notre communauté, surtout les jeunes, qui ne comprennent pas toujours la langue arabe ou berbère, me demandent pourquoi je ne chante pas en français. Je n’avais pas de réponse. J’ai commencé à accepter cette idée le jour ou Jean-Jacques Goldman m’a convaincu de chanter « Pourquoi cette pluie ». Cette chanson fait le parallèle entre les intempéries et les larmes versées par rapport à tout ce qui ce passait dans les pays du Maghreb. Je lui ai dit que je ne me sentais pas le courage de chanter en français, car je ne connaissais pas les métriques et les mots sortent différemment de ma bouche quand je veux les faire swinguer. Il m’a répondu que c’est une chose qui faisait partie de mon parcours avec lui, ou avec d’autres. Dès lors, il importe peu de s’exprimer en arabe ou en français ou dans une autre langue, à condition que cette histoire te colle. Il a réussi à me convaincre. Par la suite, il y a eu cette idée de « La France des couleurs » qui est moins un disque d’Idir qu’un concept à définir, à défendre. A la limite, nous sommes derrière ce concept et parlant de la France sans chanter en français, c’est un peu difficile. Et puis chanter en français des choses qui nous touchent d’une société dans laquelle nous sommes partie prenante en tant qu’acteurs, je ne pense pas que je me sois parjuré. Je n’ai pas cherché à plaire uniquement et a avoir, ce faisant, un auditoire. Avant tout, j’ai utilisé une langue pour exprimer des idées.
C’est étonnant que tu utilises un mot aussi fort. Pourquoi serait-ce un parjure de chanter en français ?
IDIR : C’est entre moi et moi… Ce n’est même pas par rapport au public ou à toi. C’est une belle langue, le kabyle au point d’ailleurs où, à mes débuts, je voulais être considéré comme le Robin des Bois kabyle en défendant bec et ongles, ma culture, mon identité. J’avais décidé de ne jamais m’exprimer en arabe, par résistance et non par conservatisme, et encore moins en français parce que c’est une langue que j’utilise comme outil technique, sans plus. Voilà pourquoi je parle de parjure, ce qui est peut-être un peu fort, je l’avoue.
Rester Kabyle à Paris, trente ans après ton arrivée en France, comment cela se vit-il ?
IDIR : Rester Kabyle, ce n’est pas tant échanger des idées avec des Kabyles comme toi et moi, parce que nous en échangeons tout le temps, mais garder une relation avec toutes ces choses immuables que sont la cuisine, un certain comportement.
Techniquement, pratiquement, si je peux m’exprimer ainsi, c’est quoi être Kabyle ? Est-ce en fréquentant les cafés tenus par des Kabyles qu’on garde le contact avec les racines ?
IDIR : Oui, cela permet de se ressourcer un petit peu. Un Kabyle, par définition, s’il veut être toujours Kabyle, doit rechercher son espace de prédilection. C’est la région qui lui a offert sa première lumière, où il a entendu ses premiers sons, où il a vibré les toutes premières fois. La vision qu’il a des couleurs, de la topographie des lieux, c’est aussi cela être Kabyle. C’est connaître par cœur cette ligne de crêtes du Djurdjura où ce vieux chêne centenaire… Je ne sais pas… Il y a des tas de visions que l’on a, que tu dois avoir, toi aussi. Le cadre de notre décor, c’est celui-là. On s’y meut chacun avec son humeur et son caractère. D’ailleurs, dès que l’on en sort, forcément, on change parce qu’on se retrouve dans un autre climat, une autre topographie. Éventuellement, on rencontre des gens différents, d’autres mentalités… Donc comment rester Kabyle dans tout ça ? Il y a d’abord la langue
A ton âge, avec ton parcours, qu’est-ce pour toi la kabylité ?
IDIR : C’est ce qui me fait toujours frissonner ! Ce qui me donne ce petit picotement dans mon for intérieur qui va du bassin jusqu’à la moelle épinière à la faveur d’un mot, d’un son, d’une image, d’une musique…. C’est tout cela, être Kabyle.
C’est finalement ce qui te renvoies à l’enfance ?
IDIR : Forcément, on est toujours en quête de ses origines. C’est l’un des moyens de remonter jusqu’au cordon ombilical, vers ses ancêtres, d’aller à la rencontre de Dieu où de je ne sais qui… Nous ressentons tous le besoin de cette quête. On sait qu’en remontant, de toutes façons on se rapproche d’une source. Certains diront pureté, vérité, voire lumière. On peut appeler cela comme on veut, le fait est qu’on a toujours besoin de se reconstituer, de redéfinir. Je peux être Kabyle partout, à Los Angeles ou à Bogota ou ailleurs à partir du moment où ma langue est ancrée dans mon âme, comme la poésie kabyle. Je porte cette culture des anciens, les traditions dont j’ai hérité. En vérité, je me suis débarrassé de quelques-unes…
Lesquelles, par exemple ?
IDIR : Tout ce qui est passéiste. Je me suis débarrassé des traditions qui préconisent le sexisme ainsi que de celles qui s’apparentent au communautarisme… Cela fait longtemps que j’ai jeté ces notions par la fenêtre, comme dans la religion d’ailleurs.
Tu es un artiste connu et reconnu, tu parles français. Te sens tu intégré ?
IDIR : Oui et non ! Oui, parce que je suis un partenaire à part entière, qui a des interlocuteurs viables. J’échange avec eux et ils m’apportent et ainsi j’apprends, je grandis avec eux. Non, parce qu’il y a une forme de rejet inconscient qui me renvoie toujours au petit confort douillet de ma Kabylie natale, de ce qu’elle m’a proposé à travers des discussions avec ma mère, ma famille, de l’humour que je partage avec les uns et les autres, ces chants, cette cuisine. Au milieu de tout cela, je me sens bien. Je me dis alors : est-ce que je prends tout cela tout en n’étant jamais dans le creuset de cette culture française ? Pourrais-je vivre avec eux s’ils m’acceptent ou dois-je rester là tout en étant ce Kabyle qui joue au Français dans la rue. J’ai été confronté et ai vécu tous ces problèmes. Quand on a appartenu à un clan, à une culture, à une mentalité, à une identité, je crois qu’on ne vit pas ce que l’on doit vivre ailleurs. Il y a toujours une culture qui prend le pas sur l’autre. On ne fait que s’accommoder aux choses et aux circonstances.
Chez toi, il y a quelque chose de manifeste, c’est ton accent !
IDIR : Qu’est-ce qu’il a mon accent ?
Tu gardes l’accent kabyle par le fait d’un mécanisme inconscient de protection ou défense. T’es-tu posé la question ?
IDIR : Non ! Mon accent, je m’en faisais un complexe quand j’étais lycéen. Comme il n’y avait pas de lycée dans mon village d’At Yani, j’ai dû aller sur Alger. La plupart des gens n’y roulaient pas les « r » comme chez nous. D’ailleurs, ils nous qualifiaient de ploucs ! Le fait de ne pas rouler les « r » équivalait à un reniement de soi. Rouler les « r » était un signe d’appartenance. C’est idiot, car on doit s’exprimer comme on veut. J’ai toujours mon accent, tu vois.
Mais je faisais cette réflexion par rapport à ton arrivée en France !
IDIR : Je parle et je parlerais comme j’ai toujours parlé.
Tu as un sens très fort de l’identité. Que signifie pour toi la mondialisation, une bonne ou une mauvaise chose ?
IDIR : Cela peut être une chose et son contraire. Une bonne chose dans la mesure où l’on unit les gens en effaçant les frontières, on échange des idées, de la monnaie, des objets, on fait du commerce. Cela pourrait être bien si on prenait à ceux qui en ont trop pour donner plus à ceux qui sont moins nantis. Mais la mondialisation peut aussi déboucher vers des replis sur soi ! Ces réactions extrêmes favorisent la montée de certaines idées extrémistes qui bloquent ce mécanisme. C’est curieux ce qui se passe autour de cette idée de mondialisation : je pense que l’on traverse une zone de transition, qui devra aboutir inévitablement sur un nouveau système.
La mondialisation n’est-elle pas une dissolution des identités essentialistes ?
IDIR : Forcément ! Maintenant le vrai problème, quand on se réclame d’une identité, c’est de savoir comment rester citoyen du monde tout en répondant aux exigences de notre environnement. On a l’impression que l’on va être à longue échéance « cocacolanisé». On acquiert des comportements, des attitudes, des expressions, qui tendent, à première vue, à nous éloigner de notre être originel. J’espère que cela n’est pas vraiment le cas. Mais bientôt être Kabyle ne correspondra plus à grand-chose, si ce n’est à définir un espace, un territoire, puis une histoire dans laquelle nous avons été, que nous avons vécue. Aujourd’hui nous sommes obligés de rentrer dans des notions telles que « intégration », « adaptation » « mondialisation ». Cela se fait bien sûr aux dépends de toutes les cultures minoritaires. C’est toujours le plus gros qui mange le petit !
N’est-ce pas une arme à double tranchant ? C’est-à-dire d’un côté il y a une uniformisation sur des modèles dominants tels que les Américains, etc. Mais en même temps à l’échelle des nations, la mondialisation n’empêche-t-elle pas de sortir des huis clos. La mondialisation ne détruit-elle pas les cultures minoritaires ?
IDIR : De toutes les façons, le troisième millénaire, vu le développement des médias et de la communication tel Internet, sera celui des minorités où alors il ne sert à rien d’autre que de les laisser s’exprimer, ce ne veut pas dire qu’ils vont exister vraiment. Les peuples minoritaires seront toujours tenus par le plus cynique des impératifs, celui de la survie. Pour vivre, il faut avoir les moyens et surtout les moyens d’imposer aux autres sa manière de voir, sa réflexion, sa poésie, son chant, sa peinture. Et là, il y a du boulot, la concurrence est rude et la société occidentale a mis une chape de plomb sur le reste du monde.
1973 avec la célèbre chanson « A Vava Inouva »… Peux-tu apporter un premier commentaire sur ces 35 ans de carrière ? Qu’est-ce qui a changé en toi ?
IDIR : Je ne pense pas avoir changé. J’ai évolué bien sûr, mais sur le fond, je reste profondément Kabyle, avant de dire Berbère. La notion de berbérité, je l’ai acquise. J’ai dû la penser pour pouvoir l’avoir et, à partir de là, je me suis découvert des liens de fraternité, des affinités avec l’ensemble berbère. Je me suis construit localement. Je suis le pur produit de mes parents, au départ, et ma première culture, c’est l’amour de ma famille. J’en ai pris la manière de parler. Par extension, il m’était facile d’embrasser le village entier. Je me suis senti donc Kabyle dans ce village et dans ma région. Mais le reste, je crois que je l’ai charrié. Je l’ai importé, comme on dit ! M’étant découvert des affinités, je me suis découvert aussi un sens politique, une forme de résistance avec les Imazighen, les Berbères, qui vont jusqu’à la presqu’île de Siwa. Un jour peut-être, irai-je à Siwa et en en serai-je déçu. Peut-être que je ne m’entendrais pas avec des Chaouis. Je n’en sais rien, je te livre, ici, des réflexions comme ça, en vrac. Par contre, ce qui est fascinant, c’est d’appartenir à ce territoire immense dans lequel nous avons a peu près la même base linguistique. N’est-ce pas fascinant qu’il y ait des gens qui nous soient si proches tout en étant éloignés ? D’ailleurs, la première idée, qui m’a fascinée c’était celle-ci : cette grandeur qui a dû exister quelque part où je ne pourrai la situer dans le temps. Devant l’attitude des pouvoirs respectifs qu’ils soient marocain, libyen, tunisien ou algérien, par rapport à cette question amazighe, il n’était pas question de se laisser faire. Ne pas se laisser faire non pour défendre simplement la culture, l’identité berbère, mais pour qu’elle ait droit de cité. Une fois qu’elle a acquis ce droit, c’est a elle de se débrouiller. C’est à ses enfants de répondre à la question de savoir si elle doit vivre ou pas. Cette oppression me gênait. Tout cela pour te dire que les autres choses, je les ai acquises. J’y ai milité. Mais le fait d’être Kabyle m’a été donné. C’est vertical. J’ai été révélé à moi-même comme cela et, à ce titre, je ne peux pas être autrement ou alors cela serait difficile.
Tu es né à At Yani où tu as suivi une scolarité jusqu’en classe de 3ème. Ensuite, tu as été obligé d’aller sur Alger. Ton premier rapport à la création musicale et poétique, d’où vient-il ?
IDIR : Ce rapport existait déjà depuis At Yani, bien avant mon arrivée à Alger. Ma grand-mère et ma mère disaient de la poésie. Ce que je chante dans « A Vava Inouva », je l’ai vécu. Ces fameuses soirées d’hiver où ma grand-mère nous racontait des légendes, des contes, des histoires et où on échangeait des charades, des énigmes kabyles, je les ai connues. J’ai vécu dans ce milieu, ce qui a aiguisé mon sens artistique. Par la suite, comme tous les petits kabyles du village, j’ai moi aussi gardé les chèvres et comme tous les petits bergers, j’ai un jour taillé une flûte dans un roseau. J’ai tambouriné sur un bidon de fortune et j’ai senti ces chants comme les chants profonds que ma grand-mère entamait les soirs d’hiver. Ce que j’ai vécu enfant est resté très vivace dans ma mémoire. Cela explique aussi pourquoi en arrivant à Alger, je me suis senti déraciné dans mon propre pays. C’est parce que j’arrivais dans une région où on parlait une autre langue que la mienne et dont je ne comprenais pas toutes les coutumes. D’ailleurs, je me suis fait casser la figure la première fois que je suis monté Je ne comprenais pas ce qu’il me disait. C’est ainsi qu’il me signifia, à sa manière, que je n’avais qu’à comprendre l’arabe. Le sentiment d’être différent, mis à l’écart, a renforcé mon appartenance à ma culture d’origine. Si je n’avais pas chanté, de toutes façons, j’étais comme la plupart de gens de mon âge, un enfant de l’indépendance, fier de ce qu’avait fait le pays, de ses aînés. J’ai d’ailleurs été choisi avec d’autres lycéens pour aller écouter le discours de Che Guevara à la fac d’Alger, en 1966 je crois, et de bien d’autres, tels que Yasser Arafat, Fidel Castro. Nous ressentions une fierté d’appartenir à cette Algérie, tout en ayant ce sentiment d’être brimés par les autorités de notre pays qui ne nous reconnaissaient pas en tant que Kabyles. Pour preuve, combien de fois ma mère m’a demandé de lui traduire le journal télévisé, car elle ne comprenait pas l’arabe. Et c’est à cette période que j’ai eu mon déclic, et comme la plupart des gens de mon âge, je me suis posé des questions. J’ai commencé à militer pour que ma langue maternelle soit restituée, qu’elle retrouve sa place de droit dans mon propre pays. D’ailleurs je ne comprenais pas pourquoi d’un côté les dirigeants de mon pays, prônaient la souveraineté des peuples africains, et, dans le même temps, ils me brimaient dans ma langue. Peut-être n’étions-nous pas vraiment des algériens à leur yeux ? Tout cela n’a fait qu’amplifier cette révolte que j’avais en moi, et j’ai dû l’exprimer à travers la musique. C’est pour moi cet acte militant qui a motivé l’envie de chanter.
As-tu pris de cours de musique, de solfège en arrivant à Alger, car il est manifeste que tu y as acquis une dimension musicale supérieure à celle de la flûte taillée dans un roseau ?
IDIR : En arrivant à Alger effectivement, j’avais acquis une autre dimension dans mon parcours artistique. Le Père Desaume du collège de At Yani m’avait initié un peu au solfège. Je jouais de la flûte et j’ai appris à jouer sur les petites guitares avec des gens de chez nous tel que Belkacem Imchedallen. A Alger, des coopérants techniques, qui étaient nos profs, possédaient des guitares. C’est ainsi que j’ai eu mes premiers contacts avec les accords de musique occidentale et que je m’initiais à accorder des mélodies en y apportant des arpèges. C’était l’époque de Simon and Garfunkel, des Beatles… J’aimais ces mélodies, mais je ne les ressentais pas. Dès que j’apprenais un nouvel accord, j’essayais d’imiter le rythme du bendir, sauf que c’était sur une guitare. Cette musique m’a ouvert des perspectives d’arrangement et d’agencement des notes entre elles. J’ai compris alors que les instruments étaient à ma portée, mais qu’il fallait les utiliser selon leur propre définition. Chaque instrument reproduit son propre son, mais, par exemple, si Manitas de Platas peut sortir de la guitare des sons flamencos, pourquoi n’en arracherais- je pas des sons du bendir. Pourquoi n’accommoderais-je pas les accords d’arpège en jouant avec les doigts de façon à restituer les élans principaux de nos rythmiques ? C’est peut-être ce que j’ai découvert en apprenant le solfège…
Existe-t-il une rythmique kabyle ?
IDIR : Pas une, mais plusieurs rythmiques kabyles. De même qu’il existe, comme tu le sais, différents chants, tels que celui de la procession, celui qui reflète l’activité des travaux champêtres, celui des fêtes villageoises… Les rythmiques sont multiples.
Tu as essayé, en fait, de rendre par des instruments qui ne sont pas forcément utilisés dans la tradition musicale kabyle des rythmiques qui, elles, ne sont que kabyles !
IDIR : Absolument, comme un gitan ou un manouche prend une guitare et restitue ces connotations d’Europe centrale ou celui d’Espagne te fait un flamenco. J’ai tout simplement essayé de reproduire les rythmiques du bendir. L’instrument ne créé pas la mélodie, c’est ton inspiration artistique qui la crée.
Avant de chanter « A Vava inouva » succès qui a vraiment lancé ta carrière, t’étais-tu déjà produit devant un public ?
IDIR : « A Vava Inouva » n’est pas ma première chanson ! Ma première chanson était une comptine pour enfant que devait chanter la célèbre Nouara. Elle s’intitulait « Rsed Ay Ides ». Elle devait la chanter à la télévision, mais comme elle n’est jamais arrivée. Abdel Madjid, le producteur d’une émission publique qui s’intitulait « les cinq épreuves », est venu me voir au lycée en me demandant de remplacer au pied levé Nouara car j’avais assisté aux répétitions. Je ne me sentais pas le courage de chanter, je n’étais que musicien… J’avais déjà à mon actif quelques petits succès, ce que la plupart des gens à l’époque ignoraient. Il faut savoir que, par une sorte de militantisme, je ne signais pas mes textes … Et puis, ce producteur a su me convaincre et je me suis donné pour pseudonyme Idir. C’est avec un immense trac que j’ai, pour la première fois, chanté en direct. D’ailleurs, à cause de ce trac, je n’ai pas tout de suite compris que ce public bruyant, m’acclamait en fait. J’ai pensé qu’il me huait et me demandait de sortir de scène… C’est à partir de là que ma carrière de chanteur a commencé.
Il existe des tas d’histoires au sujet de « A Vava Inouva ». L’une d’entre elles dit, par exemple, que tu as dû la chanter car personne n’en voulait à l’époque.
IDIR : C’est vrai. Il y a un chanteur qui a eu mille regrets de ne pas avoir su prévoir ce succès, c’est Slimani. Il la trouvait trop moderne. Même après l’avoir chanté moi-même en public, je ne pensais pas devenir chanteur. C’était l’aventure d’un soir après quoi, je retournerai à mes chères études. Je suis allé trouver Djamel Allam, qui était un chanteur de cabaret, ça ne l’avait pas plus accroché. Alors, je l’ai mise de côté. Du reste, à l’époque, le rythme musical de cette chanson était différent de celle qui, par la suite, a connu un succès. J’avais donc le refrain et je suis allé trouver Benmohamed pour lui demander de m’écrire deux couplets qui décrivent les ambiances traditionnelles d’antan, car je souhaitais faire perdurer dans les esprits de chacun celles-ci afin qu’elles ne tombent pas dans l’oubli. Benmohamed a donc écrit ces deux superbes couplets qui ont cimenté cette chanson.
La chanson est passée à la radio, et cela a produit un « séisme » dans le monde de la chanson, t’y attendais-tu ?
IDIR : Pas du tout ! D’ailleurs, cette chanson est venue car mon nom commençait à circuler dans la sphère musicale. Des producteurs locaux sont venus voir « ce jeune homme à lunettes », comme ils me surnommaient, et qui se faisait appeler Idir. La chanson, interprétée par Nassera, une étudiante, circulait. On commençait à l’apprécier sans savoir qui l’avait écrite ! Des producteurs ont commencé à l’entendre sur certaines ondes et m’ont mis la pression pour que je l’enregistre. J’ai été demandé conseil à Cherif Kheddam. Il m’a répondu qu’il fallait que je l’enregistre, afin qu’elle ne tombe pas dans l’oubli… J’ai donc enregistré en 10 minutes cette chanson dans un studio grâce au concours d’un technicien qui s’appelait Cheriet. Les conditions d’enregistrement étaient effroyables. Nous ne disposions que d’un seul micro pour deux voix, celle de Zahra et la mienne. Comme quoi, il suffit de peu de choses !
Et d’après toi, pourquoi cette chanson a connu un tel succès ? Et pourquoi a-t’elle contribué à sortir la poésie kabyle d’une certaine sclérose…
IDIR : Tu viens de prononcer un mot qui fait partie de ma réponse. En effet, il y avait une certaine sclérose. Les gens se suivaient et s’imitaient les uns les autres. Il y avait Ait Menguellet, qui trônait mais alors de très loin sur la chanson kabyle, avec une poésie extraordinaire. C’était le chantre de la chanson kabyle, notre idole ! Les compositions de l’époque se basaient toujours sur les mêmes structures : un refrain, un couplet, un refrain, un couplet, cela n’en finissait pas. Même si Cherif Kheddam, qui arrivait avec une nouvelle structuration musicale en créant des ponts, des répliques, cela restait toujours dans la même famille musicale. Et puis, avec deux guitares, une pour un solo et une autre pour les arpèges qui vont avec, et que l’on n’avait pas l’habitude d’entendre, et deux voix, ça le fait. Je pense que la musique a contribué au succès de cette chanson et avec, aussi et surtout, le texte qui parlait de l’histoire de nos ancêtres, de la vie d’antan dans une véritable authenticité… Je crois que ça a touché au plus profond le coeur de gens. Mais te dire précisément pourquoi cette chanson a tant marché… Je crois que si je connaissais la recette, je n’aurais fait que des tubes !
IDIR : Je pense que la mélodie a énormément contribué au succès de celle-ci car je ne m’explique pas pourquoi les gens qui ne comprennent pas la langue kabyle, ont adoré cette chanson ! La magie de la mélodie, peut être !
Au bout de combien de temps, ta mère a-t-elle compris que le célèbre Idir dont tout le monde parlait, était son fils ?
IDIR : Tu ne vas peut-être pas le croire, mais il lui a fallu le temps d’une gestation, c’est-à-dire neuf mois.
Depuis tes débuts il y a 35 ans maintenant, beaucoup de choses ont changé en Kabylie et en Algérie. Qu’est-ce qui est resté permanent, malgré tous les bouleversements ?
IDIR : Ce qui est resté permanent pour moi, c’est mon attachement à mes premiers combats, c’est-à-dire celui de la libre disposition des gens et des pays, la souveraineté des peuples, et bien sûr le combat pour mon identité. Cette identité est aujourd’hui plus que jamais en danger et tant qu’elle sera menacée, je me battrai pour sa liberté d’exister.
Mais l’identité n’est-elle pas aussi une construction intellectuelle ?
IDIR : Oui, un peu ! Mais celle qui m’importe, et que je veux préserver, c’est celle qui est en moi, celle de ma famille. Celle qui m’a construit et qui fait que j’ai, comme la plupart de gens de mon village natal, une façon bien particulière de réagir aux phénomènes et aux aléas de la vie. C’est à mon sens la meilleure définition de l’identité, de la culture… Cette identité à laquelle je tiens est liée à mon enfance. J’ai eu une enfance heureuse, malgré la guerre et les drames qu’elle a engendrés. Et puis j’ai eu une vie identitaire, culturelle, assez dense et j’ai peut-être envie de retrouver mon équilibre en recherchant cela, mais, au-delà de tout, il y a cet idéal que je me suis forgé, c’est-à-dire rester quelqu’un d’accessible autant que possible, et qui passe sa vie à partager avec les autres.
D’où vient ton combat pour l’identité ? As-tu eu dans ton enfance des modèles de « combattants identitaires » ?
IDIR : Le modèle, pour moi, c’était avant tout la prise de conscience de la Révolution, et donc de celui qui cristallisait au mieux cette identité : le colonel Amirouche, justement ou pas. C’était assez subjectif à l’époque
Parce qu’il était Kabyle ou bien parce qu’il était un moudjahid ?
IDIR : D’abord par la proximité géographique, ensuite, à cause des propos que l’on tenait à son sujet ; il avait cette aura : cet homme au caractère bien trempé n’aspirait qu’à libérer son pays. C’était à mes yeux un héros. Après, au début de l’Indépendance, j’avais un autre héros, c’était Bessaoud Mohand-Arav le fondateur de l’Académie berbère.
Comment l’as-tu connu ?
IDIR : Par la presse, par le courrier que nous recevions, telles que ces cartes d’identités en langue amazighe. On se cherchait et l’on ne se retrouvait pas dans les modèles que l’Algérie nous proposait. Et tu comprends que tu n’es pas celui que l’on te fait croire, que nous avons notre propre histoire culturelle, identitaire. D’ailleurs, nous avions à cette époque des cartes d’adhérents à l’Académie Berbère et je me souviens que nous avions des correspondant(es) dans le monde et dans les courriers échangés, la première chose sur laquelle nous attirions l’attention de nos correspondants était que nous n’étions pas Arabes mais Kabyles en précisant la genèse de notre identité… et j’avais déjà acquis cette idéologie sans le savoir, par imprégnation. Et malgré tous les obstacles, c’est tout naturellement que je me suis engagé dans le combat de la reconnaissance de l’identité kabyle.
En 1980, tu étais en France, comment as-tu vécu les événements du « Printemps berbère » ? As-tu été surpris ou bien cela t’a-t-il paru inévitable ?
IDIR : C’était inévitable parce qu’avant les événements, il y avait des échauffourées, des incidents que j’ai vécus moi-même. En tant qu’étudiant, j’ai été arrêté plusieurs fois avec d’autres. Nous avons même subi des violences de la part des policiers, comme beaucoup d’autres, mais aussi étrange que cela puisse paraître, cela faisait partie de notre quotidien. Mais l’année 1980 a cristallisé tous les antécédents qui étaient peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi significatifs. Au-delà, 1980 aura cristallisé surtout l’idée de la « berbéritude ». Nous nous sommes fabriqués tout un paysage dans lequel figurait Dda Mouloud, Laïmeche Ali, les berbéro-matérialistes de la fin des années 40. Grâce à avril 1980, nous sommes arrivés à nous construire les premières pièces du puzzle de notre histoire, c’est peut-être cela le côté positif de cet événement. Mais je précise que je n’ai jamais considéré cet événement comme le jalon primordial ; ce d’autres, qui allait aboutir au 5 octobre 1988 et à d’autres manifestations… J’ai vite compris que le combat berbère seul était moins viable s’il n’était pas rattaché à toutes les injustices que subissait le peuple et que si nous n’étions pas tous berbères, des choses nous unissaient. Un tlemcénien faisait comme un Kabyle la chaîne pour obtenir quelques denrées alimentaires. C’est ainsi que j’ai été persuadé que nous ne pouvions pas défendre notre identité sans combattre toutes les injustices commises par le pouvoir central qui opprimait sans cesse son peuple. Il fallait donc combattre l’oppression dans sa globalité et pouvoir ainsi revendiquer encore plus fort notre identité.
Cela veut-il dire que, pour toi, ton identité n’existait que dans le cadre de la nation algérienne ?
IDIR : J’étais Algérien parce que la France en avait décidé ainsi, et qu’elle a défini les frontières délimitant le Maghreb… Finalement, ce que nous avons retrouvé en 1962, c’était notre intégrité territoriale telle que dessinée par la France. Mais le fait d’être Berbère tuait ces frontières, car je me sentais Berbère chez les gens du Rif. Cela n’était pas palpable sauf par affinités identitaires, voire une même base linguistique, une même civilisation. Il fallait s’y pencher et c’était une œuvré de longue haleine, de construction progressive, mais très lente. La notion de Nation était beaucoup plus palpable. Cette nation, c’était un ensemble d’individus qui pouvait parler différentes langues mais qui était uni par un même destin sur fond de citoyenneté, de nationalité avec une histoire identique plus ou moins partagée. Les éléments idéologiques voulaient l’altérer et ne pouvaient pas avoir raison d’elle. Pas d’arabisme, car le rejet du côté arabe de l’Algérie est complètement absurde parce que je ne comprends pas à ce jour, ce que veut dire être Arabe en Algérie. Pour moi être Arabe, c’est être un habitant d’Arabie. Nous ne pouvons pas dire d’un Québécois qu’il est Français parce qu’il s’exprime en langue française. Par contre, je sais que l’Algérie est un pays où l’on s’exprime dans une forme de langue arabe, mais aussi en berbère, hébreu ou français mais tous les pays où l’on parle arabe ne sont unis que par des relations d’intérêts économiques. La guerre du Golfe a prouvé que ces pays pouvaient entrer en guerre les uns contre les autres. Je pense qu’il n’y a pas de quoi réunir une unanimité probante autour de ce sentiment d’arabité. Mais j’ai su qu’en tant que national, qu’Algérien, né Français puis l’histoire a fait que je suis devenu Algérien, j’étais uni par un destin commun avec d’autres Algériens qui parlaient une langue différente de la mienne. A cet instant, je savais que je palpais quelque chose et que mon identité se devait d’être libre, devait s’exprimer et ainsi d’être légitimée à l’intérieur de ce pays, mais sans pour autant remettre en question cette unité, apparente, et si vrai parce que l’histoire de la révolution a constitué un ciment entre les gens.
Es-tu en accord avec cette thèse selon laquelle la nation algérienne s’est construite dans le combat anticolonial !
IDIR : La nation algérienne s’est construite à partir du moment où cette forme de colonialisme est venue et que l’on a senti la différence qui existait entre eux et nous ; mais la toile de fond essentielle, c’était la différence de religion, il ne faut pas se le cacher, pas se leurrer !
Justement, je souhaitais que l’on parle de l’islam. Comment, enfant, ressentais-tu l’islam ?
IDIR : L’islam est pour moi un ensemble de réflexes culturels et c’est de cette manière que je les ai pris, sans les digérer, sans les concevoir, sans les comprendre. Le fait de jurer pour te convaincre, cela est plus un réflexe linguistique qu’une référence à Dieu. C’est comme faire le ramadan, il y a certaines personnes qui le font par acte culturel, plus que par le respect strict des cinq piliers de l’islam. Et c’est de cette manière que la religion a pénétré nos intérieurs, mais nous agrémentons à notre manière cette religion. Il y a des préceptes qui existent chez nous et pas dans le Coran. Nous reconnaissons les marabouts alors que la religion les condamne et n’a, à ce jour, jamais pu combattre toutes ces superstitions.
Penses-tu qu’il existe une pratique « kabyle » de l’islam ?
IDIR : Oui, je le pense, car comme tu le sais, chacun d’entre nous vit son propre islam, je veux dire qu’il accommode sa religion avec ce qu’il vit tous les jours, ses propres pensées, ses superstitions, voire ses croyances… Je dirai que cela pourrait ressembler à une sorte de combinaison que nous nous appliquons et dans laquelle nous vivons notre foi.
Quels sont les mécanismes qui te font penser que l’islamisme est dangereux ?
IDIR : Je pensais que c’était les difficultés économiques qui amenaient les gens à déserter les voies laïques pour aller se réfugier dans celles de Dieu. Finalement, je me suis rendu compte que non, car il existait d’autres pays aussi pauvres, mais qui, eux n’avaient, pas subi le contre coup de l’intégrisme, tels qu’une partie du Bénin, du Sénégal. Maintenant si l’intégrisme venait à envahir ces pays, cela serait lié à l’importation politique de cette idée. En fait, dans l’histoire des hommes, le fait culturel a toujours prédominé sur le politique, le social… Il fallait être soi-même, entier pour se réaliser par rapport au monde extérieur. Quand la culture, et par dérivation l’éducation a déserté l’espace territorial, la place est restée vacante pour d’autres phénomènes tels que l’interprétation assez populiste de certaines croyances religieuses ou autres…C’est là que cela devient dangereux. Si la culture n’avait pas déserté des pays tel que l’Iran, si certains dictateurs ou les dirigeants de certains pays, n’avaient pas failli en maintenant leur peuple dans l’ignorance, et si nous avions su définir la différence entre une religion et une culture, je pense que nous n’en serions pas arrivés à ses situations. D’ailleurs, si la Kabylie, et d’autres régions ont su éviter cet intégrisme, c’est parce qu’elles avaient cette raison de vivre et cette identité pas besoin de valeurs « refuges » telle que celles proposées par l’intégrisme. Les villes n’ont, quant à elles, pas pu éviter cette dictature de l’intégrisme du fait de leur cosmopolitisme qui n’a jamais su définir les identités de chacun. Les islamistes ont très vite compris qu’ils devaient imprégner par leurs propres idées les champs de l’enseignement et de l’éducation s’ils voulaient régner. C’est donc l’absence d’enseignement et d’éducation qui a fait le lit de l’intégrisme. Si l’Algérie, avait pu prendre pleinement conscience de l’importance d’éduquer ses enfants, je pense qu’elle n’aurait jamais connu l’intégrisme. A l’indépendance, nous avions tout simplement pu retrouver un territoire mais quand il s’était agi de donner une définition propre à l’Algérie, on a cru bon de la rattacher à un monde arabe abstrait et mythique. Je n’ai pas compris pourquoi cette référence puisque nous étions d’abord méditerranéens donc différents. Politiquement, je ne voyais pas autour de quel principe nous pouvions être rattachés au monde arabe car nous ne pouvions pas comparer une monarchie rétrograde à la saoudienne, à un libéralisme à la tunisienne et à l’époque à un socialisme à l’algérienne. Culturellement si toi et moi par exemple, nous n’étions pas sortis de notre village, nous n’aurions peut-être jamais parlé un mot d’arabe même dialectal. Du point de vue religieux, le fait musulman n’est pas strictement arabe, il est tout aussi bosniaque, chinois, iranien… L’Algérie, en 1962, a ignoré l’enseignement de la langue française sous prétexte qu’elle était la langue du colonialisme comme s’il y avait un amalgame entre Montesquieu, Voltaire et Diderot… Nous avons uniformisé idéologiquement une certaine apparence de l’Algérien qui devait correspondre aux critères définis par l’État, et quand on rigidifie à ce point les articulations importantes, qui pouvaient emmener un échantillon de la population vers la Lumière, il ne faut pas s’étonner qu’un jour on plonge dans des échappatoires, des couloirs qui de fait sont des sens interdits, voire des impasses. On ne nous a pas donné l’ouverture nécessaire pour porter un autre regard sur le monde dans lequel nous vivions.
Mais ne penses-tu pas qu’il y a d’autres éléments qui ont contribué à la propagation de l’islamisme tels que les calculs géopolitiques et la manipulation ?
IDIR : Bien entendu, c’est cela qui a fait le reste. Dès qu’il y a quelque chose qui bouge, c’est tout de suite à la portée des politiciens, des commerçants et puis aussi de ceux dont les intérêts reflètent ceci ou cela. Les pays occidentaux qui ne sont pas innocents dans toute cette stratégie, n’oublions pas que Khomeiny était « l’invité » de la France.
L’islamisme te paraît-il être le principal danger dans un pays comme l’Algérie ?
IDIR : Il est important, dans tous les cas. Les histoires de « concorde civile » même si cela reste un vœu pieu, je n’y crois absolument pas. Tu ne peux pas convertir une personne qui vit une autre croyance que la tienne et qui pense fermement que devenir un martyr en se tuant et en tuant d’autres, lui ouvrira des portes du Paradis où il y retrouvera ses 99 vierges en se soûlant d’alcool. C’est en reprenant le problème à sa base que tu peux combattre cette idéologie… Il faut absolument éduquer les gens afin qu’ils acquièrent leur propre liberté de penser et c’est seulement ainsi que les comportements changeront… L’intégrisme est la forme extrême de l’interprétation religieuse et dès lors qu’il est lié aux bas instincts de l’homme, nous sommes foutus. Et tout ce qui se passe en Algérie ou ailleurs me porte à croire que nous devrons, pendant quelques années encore retrousser nos manches pour combattre cet obscurantisme. Je te livre ici mon propre sentiment et non une analyse politicienne, car je veux juste être un témoin.
Revenons à la musique, construis-tu celle-ci à travers tes recherches ; je crois savoir que tu es féru de musiques sacrées, y puises-tu ton inspiration ?
IDIR : J’ai d’abord ramené avec moi beaucoup de matériaux. Pendant ma période estudiantine, j’ai sillonné mon pays et j’ai découvert, chez des personnes, un formidable répertoire de chansons ancestrales que j’ai pu enregistrer. J’étais toujours à l’affût de n’importe quel poème, histoire et je possède environ 400 heures d’enregistrement de tout ce que j’ai pu recueillir au cours de mes voyages. C’est une véritable mine d’or qui est une source d’inspiration inépuisable. J’ai eu la chance d’avoir une grand-mère et une mère poétesse… Ma mère qui est toujours en vie et avec laquelle j’ai le bonheur d’échanger, est partie prenante de mon propre univers musical. Je t’avouerai que j’ai aussi toujours eu cet amour pour la poésie d’antan que je retrouve dans n’importe quel café du XX0 arrondissement de Paris, un vieux Kabyle a toujours une histoire à te raconter et c’est ce véritable trésor que je tiens à préserver tout au long de ma vie. Et puis, sans être prétentieux, je dois te dire que je connais assez bien la genèse de mon répertoire folklorique, les instruments propres que l’on y applique, les différents genres et spécificités musicales … J’ai ainsi étudié l’évolution de la musique qui vient par exemple des Chaouias Constantinois, de l’Est qui s’estompe un peu vers Sétif et qui arrive vers Bougie et subit l’influence de la musique de la Soummam et au-delà du Djurdjura cette musique qui n’est pas très éloignée car proche des intonations de celle des chants touaregs… Je pense connaître les contours sociologiques de cette musique, et c’est dans ce bagage que je puise mon inspiration.
Quel sentiment ressens-tu quand d’autres artistes interprètent dans leur langue quelques- unes de tes chansons ?
IDIR : Tu touches du doigt une sensation très importante pour moi. Même si j’ai jeté depuis bien longtemps ces sentiments d’honneur et de fierté « kabyles » par la fenêtre, car je pense que nous devons vivre tels que nous sommes c’est-à-dire simplement sans aucune fierté, être juste un homme, j’avoue que quand j’entends un artiste qui habite dans un pays très éloigné du mien, et qui a simplement ressenti ma mélodie, la reprend dans sa propre langue, je me dis que je suis arrivé grâce ce que je transportes dans mon petit bagage musical, à communiquer avec lui au-delà de nos frontières et de nos différences religieuses ou autres, à lui inspirer juste une émotion et j’en tire beaucoup de plaisir et je me sens quelque part utile !
D’ailleurs, peux-tu nous raconter cette anecdote où au cours d’un de tes spectacles, tu as rencontré des personnes qui t’ont remercié d’avoir repris une chanson turque !
IDIR : C’était à Hérouville-Saint- Clair où vit une forte population turque. J’étais en train de chanter « Azgar » et à mon grand étonnement une partie du public s’est levée et a commencé à danser. Après le spectacle, certains sont venus me dire que c’était très gentil de ma part d’avoir repris cette chanson du répertoire turc… Je leur ai signalé que j’étais bien l’auteur de la chanson, qui avait été reprise par une célèbre chanteuse d’origine turque. Qu’elle ne fût pas leur surprise car ils étaient persuadés du contraire !
Le fait de ne pas chanter en Algérie ne te manque-t-il pas ?
IDIR : Forcément… Mais cela me manque surtout de ne pas chanter en Kabylie, puisque mes textes racontent la vie quotidienne des habitants de cette région où j’ai grandi ! Ailleurs, également, parce que l’on a envie d’être reconnu au-delà de sa propre région, de son propre village ! Et je t’avoue qu’avec les années, ce sentiment devient de plus en plus mythique. Il ne me reste plus que cette « kabylité », qui est en moi. C’est cette région qui m’a porté et qui m’a laissé m’exprimer et cela a été mon tout premier public et je lui suis redevable… Je ne fais jamais un disque, sans penser a lui, même si c’est un disque tel que celui de « La France des couleurs » ou « Identités » qui sont un peu éloignés de la culture kabyle. Je ne compose jamais sans avoir une pensée où est concernée une partie des habitants de cette Kabylie. D’ailleurs, quand je retourne en Algérie, ce pays que j’aime, même si je suis un nationaliste révolutionnaire, comme diraient certains, cette kabylité, je la sens en moi. Je la palpe tous les jours, malgré le sentiment d’insécurité qui m’envahit dès que je pose un pied sur le sol algérien.
Il y a environ un an, tu as effectué un voyage en compagnie de Zidane, en Algérie. Les gens de ton village ont été frustrés que tu ne sois pas allé les voir.
IDIR : Mais je tiens ici à préciser les choses. Je n’ai pas été invité officiellement par l’Algérie. C’est Zidane qui m’a demandé de l’accompagner car je représente à ses yeux une référence identitaire qui définirait le lien entre ses parents et lui. J’ai accepté sa proposition en lui signalant que, de par mon histoire je ne souhaitais pas être associé au pouvoir algérien. Zidane a donc été le seul invité officiel et, vu sa popularité en Algérie, nous avions des plans de voyage qui n’ont pas été fixés par nous, et qui changeaient tous les jours. Descendre en Algérie sans aller en Kabylie, cela m’a coûté !
Aujourd’hui quels rapports entretiens-tu ou entretenais-tu avec les principaux chanteurs kabyles, tel que Matoub Lounès ?
IDIR : Bien entendu, j’ai même eu le grand honneur d’assister à ses débuts. Quand il est arrivé en France, il est venu me rendre visite et je l’ai aidé… Et puis son immense talent a fait le reste. Nous sommes devenus de véritables amis, partageant d’autres choses que la chanson, les choses de la vie comme on dit ! Il y a un autre chanteur avec qui j’ai eu très vite des affinités, c’est Ait Menguellet. J’ai la même d’admiration pour lui que celle que j’avais pour Matoub. Nous avons partagé ensemble de forts moments… Je pense qu’il existe peu de chanteurs avec lesquels je ne me sois entendu… A chaque sollicitation de leur part, j’ai modestement donné ce que je pouvais. C’est vrai que j’ai une certaine nostalgie de nos anciens chanteurs, les jeunes me parlent un peu moins parce que, politiquement, ils n’ont rien à m’apprendre et je n’ai rien à leur apprendre ; et puis, j’ai beaucoup de difficultés à ressentir l’émotion qu’ils transposent dans leurs chansons…
Comme les principaux chefs de file de la chanson kabyle, tu es souvent imité par des jeunes artistes ! Comment analyses-tu ce phénomène ?
IDIR : Oui j’ai remarqué cela… mais c’est peut-être parce qu’il existe un manque de véritable vocation. Nous avons tous besoins de mythes, de repères, que l’on a quelquefois perdus… Et puis, on aime la musique pour la musique, cela n’est pas pour autant que la vocation, le don est présent. D’ailleurs, j’ai remarqué qu’en Algérie, dès qu’un nouvel artiste sort son premier disque, s’il doit faire carrière, c’est tout de suite ou jamais… Il n’existe pas, comme en France, ce mythe du chanteur qui bouffe de la vache enragée pendant quelques années et qui, après, arrive enfin à percer tel que Charles Aznavour, Brel, Brassens… Par exemple, Hasnaoui, Cherif Kheddam, Idir ont tout de suite été reconnus. Je ne parle même pas du phénomène Slimane Azem, Matoub ou Menguellet… Le public adule ou rejette tout de suite, il n’offre pas de seconde chance ! D’ailleurs, ce public s’est rarement trompé et c’est curieux, car si tu analyses le répertoire de la chanson kabyle, tu découvres qu’il existe un lien très fort qui unit dès le début le chanteur à son public ! Ce qui explique pourquoi aucun artiste ne peut manger de la vache enragée comme dans d’autres pays. D’ailleurs, il n’existait pas d’intermédiaires entre le chanteur et son public, nous n’avons pas d’imprésarios par exemple !
Cela s’explique par le fait que la chanson kabyle a été le média de l’expression d’un peuple car il n’y avait aucun journal, pas de radio ni télévision qui puissent relayer cela !
IDIR : Et nous avions des places de choix. D’ailleurs, à l’époque, n’importe quel kabyle achetait écouter ce que l’artiste avait à dire et quel était le message qu’il voulait lui transmettre !
En dehors de la presse, quelles sont tes lectures ?
IDIR : Je lis un peu de tout, surtout des magazines… Mais aussi de temps à autre des livres. Le dernier livre que j’ai lu est « Le livre de ma mère » d’Albert Cohen. Il s’agit d’un travail sur soi, car l’auteur a eu des relations très conflictuelles avec sa mère et il a essayé de retranscrire celles-ci en leur donnant un angle différent. J’aime bien aussi les polars, et j’aime beaucoup les études de caractères, je suis assez classique dans mes lectures, un peu balzacien sur les bords !
Tu lis un ouvrage par mois, par trimestre, par an ?
IDIR : Mes lectures sont liées au rythme de mes spectacles… J’en fais énormément, et je lis environ un livre par mois, pas par ennui de l’artiste qui se retrouve seul dans sa chambre d’hôtel, mais par envie ; et c’est vraiment le seul moment où je peux consacrer du temps à la lecture.
Et en musique, écoutes-tu du classique ?
IDIR : Beaucoup, car, tu le sais, la musique classique est partagée par trois grands compositeurs. Le reste en est dérivé. La virtuosité avec Mozart, le génie avec Beethoven et la technique avec Bach et après eux, on a plus rien inventé. La puissance et le génie de Beethoven font que ses symphonies sont très complètes même s’il y a une qui se nomme « symphonie inachevée » ; la légèreté et l’ingéniosité de Mozart a rendu sa musique accessible au plus grand nombre d’entre nous car très vivante. Bach avec ses fugues et sa technique du contre pointe donne une idée complète de ce que peut être la rigueur dans la musique. Et puis après sont venus Haydn, Chopin, Tchaïkovski, qui ont défini les prémisses du folklore qui s’instille progressivement dans les musiques classiques jusqu’à l’arrivée de Bartok qui a banalisé tout cela.
Peux-tu nous décrire en quelques mots le processus de la création d’une chanson ?
IDIR : Il n’y a pas de véritable processus, pour ma part. Rien n’est défini à l’avance, c’est peut-être cela la véritable création. Et puis, l’inspiration ne vient pas uniquement devant une feuille blanche. Elle peut aussi se situer dans des échanges comme ceux que nous avons en ce moment… Il suffit parfois d’un mot qui va m’interpeller et devenir le fil conducteur qui m’amènera à créer soit des paroles ou de la musique, tout ce qui fera une chanson, bien entendu quand je suis à la fois auteur compositeur. Par contre, quand il s’agit de collaborer avec d’autres artistes, ce que l’on appelle la chanson dite militante, comme celle écrite en collaboration avec Benmohamed, le travail et l’inspiration sont différents. Mais je reconnais que je n’ai jamais pris autant de plaisir que quand je compose par moi-même d’abord une musique et puis j’y colle des mots, je crois à la valeur des notes plus que les mots, même si chez nous les mots priment sur les notes. Notre poésie est profondément populaire, elle a souvent puisé son inspiration dans le quotidien des gens. Par exemple, quand un villageois découvre qu’un autre a dérivé le cours du ruisseau à son profit, sa réaction se traduit par des mots qui peuvent être violents mais qui, par leur magie, vont former toute une poésie qui va s’imprégner la mémoire collective. Cela me laisse perplexe, et je suis toujours étonné par où l’origine de la quintessence de la poésie. D’ailleurs, les mots sont plus forts à mon sens que le son produit par nos quelques instruments tels que la flûte ; ils ne nous offrent pas la panoplie complète pour pouvoir restituer des émotions. Nous ne possédons pas, dans notre répertoire, des instruments tels que le violon, la harpe qui peuvent à eux seuls, traduire des émotions. C’est pourquoi j’ai vite ressenti que seule la puissance des mots pouvait apporter une dimension supplémentaire à la musique traditionnelle kabyle.
Dans ton dernier album, tu chantes en compagnie de ta fille un texte écrit par Grand Corps Malade. Peux-tu nous expliquer la genèse de cette chanson ? C’est la synthèse de quelque chose à laquelle tu t’attendais dans ton parcours d’artiste ?
IDIR : Officiellement, peut-être que non ! Mais je suis très proche de mes deux enfants, avec lesquels je partage la musique. Mon fils est guitariste et ma fille pianiste. Je leur ai conseillé d’avoir également une formation en musique classique pour la rigueur, en les alertant sur le fait qu’ils devraient par la suite s’en éloigner afin de pouvoir s’ouvrir à d’autres musiques, telle que le répertoire kabyle. A la maison, nous jouions souvent tous les trois ensemble. Mais je n’aurais pas imaginé que ce que je partageais avec eux dans notre intimité nous amènerait à le partager sur une scène devant un public. Je les ai toujours protégés des dangers de ce milieu artistique. Je ne souhaitais pas qu’ils aient tous les deux une image faussée par la notoriété de leur père qui aurait pu leur apparaître comme une icône. Je voulais et je veux tout simplement être un père comme les autres. Quand j’ai commencé à travailler avec Grand Corps Malade sur ce texte ma fille n’était pas loin. Elle m’a dit qu’elle trouvait le texte magnifique et profondément juste car il collait à la réalité que certaines filles de son lycée vivaient. Elle m’a donc proposé quelques mélodies qui pouvaient accompagner ce texte et nous avons décidé d’aller au bout de notre collaboration en chantant tous les deux cette chanson. Pour revenir à ta question, le fait que ce soit ma fille qui ait choisi de faire la musique de cette chanson parce qu’elle a été sensible à celui-ci m’a intéressé, non pas parce que c’est ma fille, mais parce ce sentiment, d’autres auraient pu le ressentir. J’avais d’ailleurs peur que cela soit mal interprété par mon public. Je ne voulais surtout pas qu’on pense que je souhaitais l’imposer. Mais quand je me suis aperçu à quel point elle vivait ce texte, qu’elle avait véritablement envie d’être partie prenante, alors je lui ai dis pourquoi pas ! Le véritable plaisir que j’ai retiré de cette expérience, c’est cette cohérence entre Grand Corps Malade, ma fille et moi pour partager ce thème. Mais ce je que je raconte dans cette chanson, je ne le dédie pas à ma fille car elle ne vit pas les conditions décrites dans ce texte.
Propos recueillis par Arezki Metref
in Actualités et culture berbères, n° 56/57 Automne-Hiver 2007