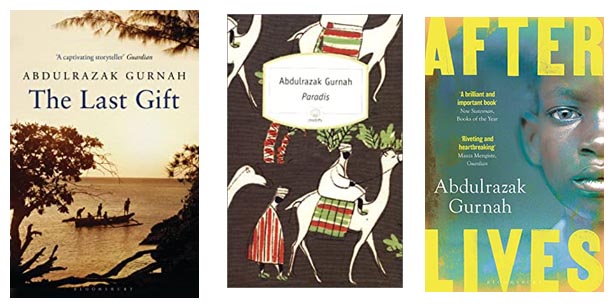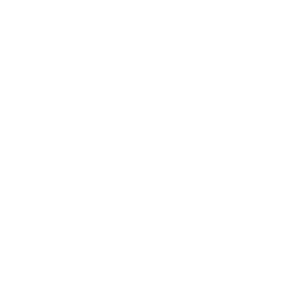L’Académie suédoise a décerné jeudi 7 octobre Le prix Nobel de littérature 2021 au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah. Selon le jury, l’auteur a été récompensé pour sa narration « empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents ». Son œuvre s’éloigne des « descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l’Est diverse culturellement qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde », a expliqué le jury. « Abdulrazak Gurnah a appelé l’Europe à voir l’arrivée des réfugiés venus d’Afrique comme une richesse. « Beaucoup de ces gens qui viennent, viennent par nécessité, et aussi franchement parce qu’ils ont quelque chose à donner. Ils ne viennent pas les mains vides », a affirmé l’écrivain dans une interview à la Fondation Nobel, appelant à changer de regard sur « des gens talentueux et pleins d’énergie » (Le Monde 7 octobre)
C’est dire l’actualité du propos en ces périodes électorales pathétiques, c’est dire aussi la pertinence du propos du point de vue des « Suds » c’est-à-dire des aspirations des peuples qui, débarrassés de la main mise coloniale, aspirent toujours à la justice et la démocratie. Un prix Nobel qu’il convient de saluer pour ce qu’il dit du monde moderne, de ses « ignorances » et du trop-plein de « méfiances ».
Professeur de littérature à l’université de Kent jusqu’à son départ à la retraite, installé du côté de Brighton, Abdulrazak Gurnah est l’auteur de plusieurs romans dont Paradis (traduit par Anne-Cécile Padoux au Serpent à plumes en 1999) et Desertion (traduit en français sous le titre Adieu Zanzibar par Sylvette Gleize, Galaade, 2009).
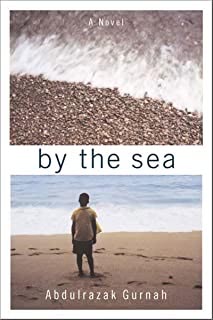 Retour sur son roman Près de la mer paru en traduction française en 2006 chez Galaade éditions. Traduit de l’anglais par Sylvette Gleize.
Retour sur son roman Près de la mer paru en traduction française en 2006 chez Galaade éditions. Traduit de l’anglais par Sylvette Gleize.
« Je suis un réfugié, un demandeur d’asile. Ces mots ne sont pas simples, même si l’habitude qu’on a de les entendre les fait apparaître comme tels. J’ai débarqué à l’aéroport de Gatwick en fin d’après-midi le 23 novembre de l’an dernier. C’est un point culminant, mineur et familier de nos histoires que de quitter ce que l’on connaît pour arriver dans des lieux étranges, emportant avec soi pêle-mêle des bribes de bagages, bâillonnant des ambitions secrètes et embrouillées. » Saleh Omar, le demandeur d’asile, est un homme âgé de soixante-cinq ans ! Singulier et improbable exil que celui d’un sexagénaire déjà bien tassé. Le vénérable n’est pas sans papiers, c’est-à-dire sans identité, sans histoire, non ! mais il arrive tout de même en Occident avec de faux papiers, des papiers au nom de Rajab Shaaban. De plus, par sécurité, par peur d’un faux-pas, Saleh Omar, alias Rajab Shaaban, reste muet ; laissant aux autres, aux fonctionnaires de l’immigration comme aux travailleurs sociaux, le soin d’interpréter son silence, le soin de parler pour lui, le soin de poser les questions et d’apporter les réponses…
Le hasard des arcanes socio-administratives le met en relation avec Latif Mahmoud, poète et professeur de littérature installé à Londres depuis une trentaine années, qui avait, du moins le croyait-il, définitivement, coupé les ponts avec les siens. Ces deux-là viennent du même coin d’Afrique : Zanzibar.
Il y a bien longtemps les deux hommes se sont croisés. Pourquoi Saleh Omar a-t-il usurpé l’identité de Rajab Shaaban, le propre père de Latif ? Quel passé lie et quels terribles secrets opposent le vieux Saleh et le jeune Latif ? Là est l’autre thème du livre : brosser sur plusieurs décennies l’histoire de deux familles et l’histoire d’un pays. Il revient aussi sur le passé de cette côte orientale de l’Afrique. Une histoire marquée par les pénétrations étrangères depuis les Portugais jusqu’aux Français en passant par les Omanais, les Britanniques et autres Allemands et les liens commerciaux et maritimes plurimillénaires entretenus avec l’Orient – Bahreïn, l’Arabie, le Golfe Persique et l’Inde, lointaine et envoûtante.
Et oui ! semble dire Abdulrazak Gurnah, derrière ces faces apeurées de réfugiés et autres demandeurs d’asile se cachent des vies d’hommes et de femmes, des existences parfois insolites. Toujours insoupçonnées. « On se méfie généralement des choses qu’on ignore » dit un proverbe arabe. Ignorance et méfiance sont ici incarnées par Kevin Edelman, le fonctionnaire des douanes qui « cueille » le réfugié à sa descente d’avion : « Pourquoi ne pas être resté dans votre pays où vous pouviez vieillir en paix ? L’asile politique, c’est bon pour les jeunes, parce que ce qu’ils veulent c’est trouver du travail et gagner de l’argent, non ? Rien de moral à tout cela. La cupidité, c’est tout. On ne craint pas pour sa vie ou sa sécurité, il n’y a que la cupidité. Monsieur Shaaban, un homme de votre âge devrait se montrer plus avisé. » Pourtant écrit Abdulrazak Gurnah « Kevin Edelman, le bawab d’Europe, le gardien des vergers, [est] celui qui a ouvert toutes grandes les portes et lâché les hordes à l’assaut du monde, ces portes vers lesquelles nous rampons dans la boue en implorant qu’on nous laisse entrer. Réfugié. Demandeur d’asile. Pitié. »
Dénonce aussi l’arbitraire, la gabegie, le pouvoir oppressif et dictatorial, la pauvreté économique et la misère sociale dont sont d’abord responsables les nouveaux maîtres des pays nouvellement indépendants. La question démocratique ne serait-elle pas finalement la grande cause des migrations et des exils ? Il ose cette phrase, à faire pâlir d’effroi nos excessifs et autrement favorisés Indigènes de la République – prononcée aussi et parfois, mezza voce bien sûr, par des Algériens – : « Il semblerait ainsi que les Britanniques ne nous aient apporté que du bien, comparé aux brutalités que nous fûmes capables de nous infliger à nous-mêmes. »
Mais Abdulrazak Gurnah est d’abord un romancier qui ne s’embarrasse pas de démonstrations militantes et de simplifications de chapelle. Il dénonce ces « identités meurtrières » qui sommeraient Latif de devoir choisir entre « ici ou là-bas » entre « l’un ou l’autre ». Il s’irrite du mépris affiché en Occident à l’égard des cultures d’origine et de l’universalisme à géométrie variable de ces valeurs qui ne seraient réservées qu’aux seuls Européens… « mais le monde entier a payé le prix des valeurs de l’Europe, même si bien souvent l’on s’est contenté de payer et de payer encore, sans pouvoir profiter de rien. »
Abdulrazak Gurnah écrit cette histoire, à la fois conte merveilleux et tragique, sur un ton linéaire et distancé, dans une langue empreinte d’un élégant et apaisant classicisme. Point de vagues ici. Si ce n’est celles des existences et des ignorances.
Mustapha Harzoune