Houris, de Kamel Daoud ou la nécessité de dire
Kamel Daoud vient de recevoir le Prix Goncourt 2024 pour son roman Houris, un roman sur la guerre civile algérienne mais aussi et peut-être d’abord un roman pour les femmes, les femmes algériennes, les femmes afghanes, désormais privées de voix, ou les femmes iraniennes à l’instar de cette jeune étudiante qui s’est dévêtue en signe de protestation. Houris est un roman terrible mais aussi un roman qui dessine un chemin d’espoir.
« Te garder ? Es-tu folle ? Ils se sont montrés capables d’enterrer une guerre entière, 200 000 morts et dix années durant lesquelles ils se sont pris pour des moutons et des prophètes, mais ils n’oublieront jamais que tu es née sans père, sans nom. » Une jeune femme parle à la fille qu’elle porte et qu’elle appelle Houri. Quand Daoud croise ici Histoire, celle de la guerre civile algérienne – et le destin de trois femmes à travers les mots et la langue de l’intérieur d’Aube, « Fajr dans la langue extérieure, Aube dans la langue intérieure. »
Aube a 26 ans, elle a failli mourir égorgée sous la lame d’un islamiste, « mais l’égorgeur rata son sacrifice », elle vit, depuis l’âge de cinq ans avec cette « monstruosité » sur le corps : « un sourire qui noue mes oreilles l’une à l’autre. C’est juste là, sur mon cou ». Pour cette miraculée du couteau, il est impossible que son corps mort depuis cette nuit terrible du 31 décembre 1999 puisse donner la vie. Il lui est impossible d’enfanter une fille dans un pays qui est « un couloir d’épines » pour une femme, dans une histoire où elle ne sera « à peine plus importante que l’un de ces moutons » promis au sacrifice de l’Aïd : « depuis une semaine, toute la ville empeste les viscères et la terreur des bêtes » dans les quartiers des banlieues, dans les Cités « c’est l’étable ouverte, les bêlements éprouvants ». Le parallèle est clair. Mohamed Kacimi, dans La Confession d’Abraham, avait déjà fait dire à Sarah, l’épouse d’Abraham : « Il met quarante ans avant de me donner un enfant et maintenant qu’il est là, il veut en faire un barbecue… ». Houri, elle, est promise à la mort avant de naître.
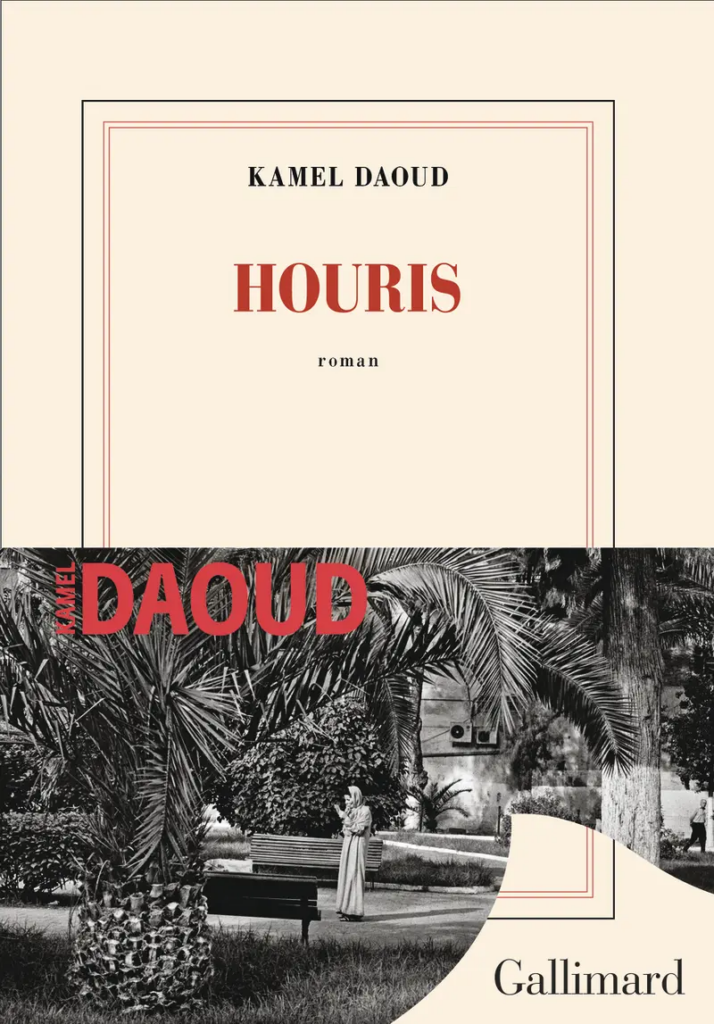
Khadidja l’enfant abandonnée de l’indépendance, le 5 juillet 1962, a sauvé l’enfant, lui a donné son prénom et est devenue sa mère adoptive « Ma mère Khadija » (…) rejoignit sa propre histoire d’orpheline adoptée qui souhaitait réparer le monde et s’offrir en tuteur », « elle m’a appelée Aube pour contrer deux destins de nuit, le sien, le mien. » Khadija, Aube, Houri ou la malédiction des femmes, la malédiction d’un pays : abandonné, meurtri et sans voix, sans avenir enfin.
Aube, de sa voix intérieure raconte et parle à l’enfant. Trois temps rythment le récit, l’histoire et le quotidien d’Aube, sa rencontre avec Aïssa alors qu’elle est en route vers « l’Endroit mort où j’ai été égorgée » et son retour à Had Chekala, le village martyr où tout a commencé et tout se terminera. A noter que Kamel Daoud connait Had Chekala, puisqu’il fut l’envoyé spécial du Quotidien d’Oran pour y couvrir le massacre, et qu’il fut le premier à récolter le nombre de 1000 morts de ce « Grand Massacre » islamiste.

Le procès
Comme il a été écrit ailleurs, Houris est très certainement un roman imparfait : trop long (notamment la deuxième partie) et souvent répétitif, monomane aussi au sens où, à le lire, de bout en bout, une question gagne le lecteur : « l’Algérie ce n’est pas Kaboul tout de même ? »… Ce qui demande à être vérifié. D’abord libre au romancier de promener son miroir sur les chemins qu’il se choisit. Libre à lui de décrire, de dénoncer et d’esquisser des raisons d’espérer. Pour paraphraser Stendhal, le miroir de Daoud montre la fange et c’est le miroir qu’on accuse. Ce que décrit Daoud existe : les atrocités des années noires et la caporalisation de ses mémoires, l’islamisation de la société et la mise au pas et à l’écart des femmes. Il suffit d’entendre ou de lire ces Algériens qui parlent eux de « talibanisation » pour en être convaincu. Il y a l’Algérie, mais il y a les Iraniennes et cette jeune étudiante qui s’est dévêtue en signe de protestation, il y a les Afghanes à qui il est interdit de parler en public et désormais entre elles ! La publication d’Houris a suscité bien des engouements, jusqu’au prix Goncourt. Mais les réactions de rejet sont aussi allées bon train, de l’universitaire donneuse de leçons, au texte dégoulinant de suffisance et de pédanterie, au journaliste homologué halal qui, tel une houri effarouchée, s’époumone en procès en islamophobie, essentialisme et autre « orientalisme inversé ». Quand la littérature elle-même est gagnée par une dégringolade de la pensée, un jeu algorithmique ou idéologique du oui ou du non.
Sans oublier le procès en trahison. La France, a une expression pour cela, on y parle de « cinquième colonne », en Algérie on vous accuse d’être du « parti de la France » ! Et cela date, et cela n’est pas original (lire le roman d’Amira Ghenim, Le désastre de la maison des notables, Philippe Rey, 2024, sur la réception du livre écrit par Tahar Haddad sur la femme et la législation islamique et publié en… 1930).
Les deux langues
Pourquoi ce procès ? Parce qu’Aube dit posséder deux langues. Celle de l’intérieur, qu’elle qualifie de « belle », « celle avec laquelle je me raconte des histoires » ou dont « j’use quand je parle dans ma tête à mes ennemis, voisins, imams, à Dieu qui m’a volé des choses précieuses », celle aussi où se niche la voix des personnes qu’elle a aimées et l’autre, celle de l’extérieur, elle qui est « muette » dans cette « langue de dehors », une langue « rauque et incompréhensible », un « marécage » d’« exhortations et de menaces » où se joue et se « rejoue la fin du monde du matin au soir ». Daoud n’est pas le premier à mettre en miroir la langue française et l’arabe algérien ; Assia Djebar le précède sur le thème. Mais le sujet est loin d’être épuisé et surtout il est central, déterminant pour la définition des langues et des cultures algériennes, pour en finir avec la guerre des « couleurs » en Algérie pour reprendre l’image des poètes Ahmed Azzegagh ou Jean Sénac. De plus il s’agit ici d’un faux procès : pour Daoud, il ne s’agit pas d’opposer deux langues, deux héritages, mais plutôt de les faire « concorder » (le mot est dans le roman), de faire advenir cette confluence notamment chez les générations à venir.
Nommer les choses
Houris porte des descriptions insoutenables : égorgement, massacres, « rites » du sacrifice, « sourire monstrueux » d’Aube, la canule par laquelle elle respire qu’il faut changer et nettoyer. Toutes ces descriptions sont longues, précises, chirurgicales, terribles. Pourquoi ? Pas par complaisance, mas parce qu’il faut nommer les choses comme dit Camus, il faut dire et décrire non par un dégoulinant et creux devoir de mémoire mais pour engager un nécessaire processus cathartique. De ce point de vue Houris de Kamel Daoud a beaucoup à voir avec Jacaranda de Gaël Faye (Grasset 2024, et prix Renaudot) sur le génocide. De ce point de vue Houris de Kamel Daoud a beaucoup à voir avec Jacaranda de Gaël Faye (Grasset 2024, et prix Renaudot) sur le génocide des Tutsis. Ici, réconciliation ne rime ni avec amnésie ni avec amnistie. Au Rwanda la justice passe par des commémorations et les gacaca, les tribunaux populaire publics. Cette justice est imparfaite, mais elle a le mérite de libérer la parole et de mettre fin à l’impunité. Il n’y aura ni pardon, ni réconciliation mais ces procès « sont absolument nécessaires pour les générations d’après » dit l’un des personnages de Jacaranda.
Houris, le roman des femmes
On a présenté, en France, Houris comme un roman – le premier même (sic) – sur la décennie noire. Il est aussi un roman sur la femme algérienne, les femmes algériennes. A commencer par Aube : elle tient un salon de coiffure, Shéhérazade « écrit en lettres lumineuses roses au-dessus de la porte », elle y a accroché « des photos de femmes aux lèvres pulpeuses, aux corps splendides » et ce salon fait face à… une mosquée ! Aube est indépendante, libre, fume et marche « les cheveux à l’air et les épaules nues », verticale dans son « « insolence de femme sans homme et donc sans peur des hommes ». Avec ce qu’elle nomme « la mosquée du Cercueil » c’est la guerre. « Mais je tiens tout le monde à distance avec mon « sourire » de monstre et mes yeux immenses où ils n’aiment pas se regarder. » « Une petite guerre » entre « ma canule et le haut-parleur du prêcheur », « entre mes houris et les houris de l’imam d’en face ». Et, lorsque lors d’un de ces matchs du vendredi, « jour maudit pour les femmes », l’iman égrène du haut de son haut-parleur la liste des « dix femmes exclues de la miséricorde de Dieu (…) jusqu’à ce qu’il ne reste rien (…) Que des ombres poilues, des silhouettes muettes et des mortes aux voix douces pour dire « oui » à l’homme » dans le salon de coiffure, « on resta plongées dans un silence de rescapées ». « C’est avec ses mots à lui, pas les miens, ma Houri, qu’on a tué des centaines de milliers de gens durant les années 1990 et jusqu’à ma mort le 31 décembre 1999, et il le sait » dit Aube à sa fille.
Oui, Houris est un roman sur la guerre civile, mais il est aussi et peut-être d’abord un roman sur les femmes, sur la célébration de la beauté contre la laideur, de la liberté contre l’enfermement. Plutôt que de tirer à tort et à travers contre Kamel Daoud, il faut relire le grand Driss Chraïbi à commencer, sur le sujet, par La Civilisation ma mère (Denoël 1972).
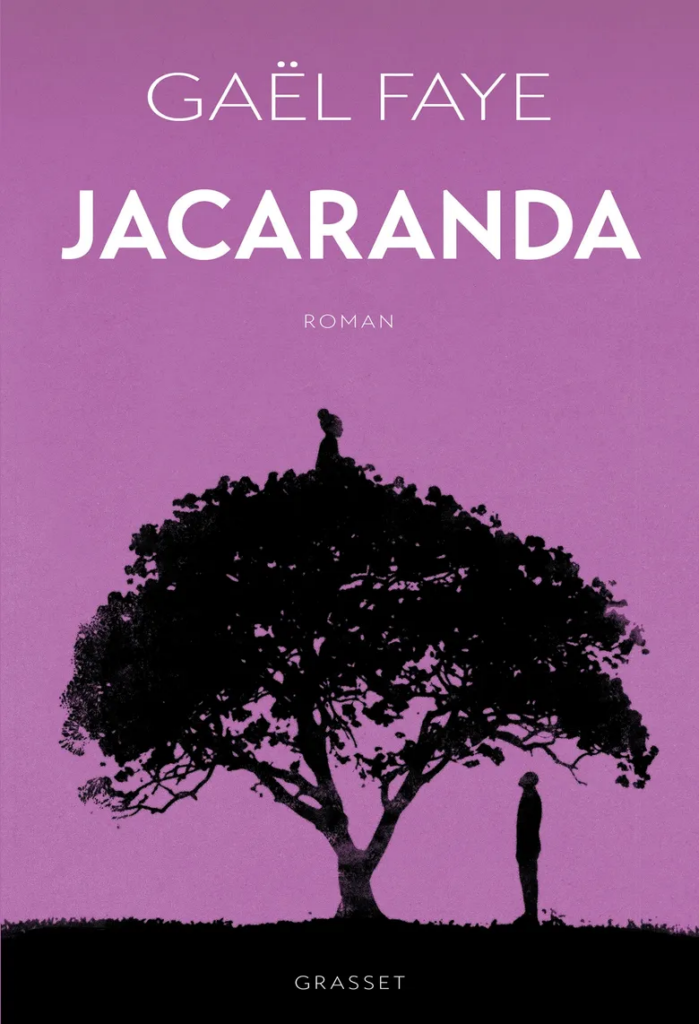

Alors, Aube s’adresse à son enfant : « C’est ça être femme ici. Le veux-tu vraiment ? ». Le roman multiplie les histoires et les portraits de femmes, de femmes algériennes, de femmes au destin brisé, prisonnières, écrasées sous la férule des hommes : ses employées Hanane et Meriam, les trois femmes chassées de leur appartement, Zahra, la mère de Mimoun le pêcheur qui veut partir en Espagne, celui qui la mise enceinte ou encore Hamra cachée dans une burqa comme dans un linceul, étiquetée « terroriste » parce que kidnappée, violée, engrossée, déshonorée quand les hommes, ceux qui ont tué et violé se voient offrir des dattes, du lait et des pensions au nom de la Réconciliation. Autant de femmes qui toutes « avaient perdu leur voix », « les cordes vocales tranchées ».
« Les cartes truquées de la mémoire servile »
Aube, elle, est « un livre », le « véritable livre, le récit de ce qu’on ne doit pas oublier, un alphabet que seuls les ignorants ignorent ». Elle est le livre unique « qui protège de l’oubli la véritable histoire de la vraie guerre d’Algérie ». Déjà en 1966 le poète Ahmed Azeggagh (encore lui !) dénonçait les « cartes truquées de la mémoire servile ». Daoud dénonce, à travers « les cicatrices calligraphiées » d’Aube, l’effacement de la guerre civile, l’effacement « du jour où l’on tenta de m’égorger ». Oui, constate Aube, la vie semble continuer, comme si rien ne s’était passé et, sous le soleil d’Oran, « mourir semble une médisance ». Tous ces appels, ces injonctions, ces prêches, ces menaces et autres lois ne célèbrent que « la réconciliation des meurtriers avec les meurtriers ». « Et nous, nous sommes tous morts, et je crus, à ce moment-là, que j’allais périr étouffée ».
Sortir du labyrinthe
Aube décide de partir vers « le pays de ma sœur défunte », pour sortir du « labyrinthe », pour tuer ou ne pas tuer – « c’est ma sœur qui tranchera » dit-elle. Sur la route elle est agressée et se retrouve dans la voiture d’Aïssa, un commercial en livres de cuisine, un « fou enfermé dans son histoire » celle d’une famille, elle aussi, décimée par la barbarie islamiste. Lui qui est la mémoire des massacres, des lieux, des noms et des chiffres cherche des « preuves ». Sa jambe de bois ne prouve rien, alors que la canule est « un signe de Dieu ». « Personne ne me croit plus dans la vraie vie et je ne sais pas écrire » dit-il. A Aube, il raconte sa convocation par un colonel qui lui intime l’ordre de la fermer, pour préserver la paix dans le pays. Oui cela est répétitif, le lecteur a compris qu’officiellement il ne s’est rien passé, et pourtant par cette scène, Kamel Daoud montre les tourments d’un Algérien face à cette autorité, il montre à quel point le pouvoir et ses représentants, peuvent briser n’importe qui, à n’importe quel moment !
Le retour à Had Chekala sera difficile. Aube pense que « ces gens auraient dû réciter les noms des morts chaque heure, témoigner sans jamais s’arrêter » mais rencontre des habitants hostiles qui préfèrent oublier ou selon le vieux fou Ennaz, mentir sur qui ils sont. Le face à face tendu avec l’imam, la barbe noire « affûtée comme une lame », l’égare comme dans un labyrinthe où se mélangent les vivants et les morts, les coupable et les innocents, les noms de familles, réels ou non, celles et ceux qui ne veulent pas se souvenir, les complices et les autres, les lachetés, les culpabilités, les hontes, les vies reconstruites sur des vols et des mensonges… Pire, « il me poussait dans ma tombe avec la certitude que j’étais aussi coupable que celui qui tenta de m’égorger il y a vingt et un ans ».
Aube ne cède pas, par sa langue intérieure « cabrée », elle résiste pour affronter son destin : « cette fois, j’allais plonger comme mille personnes dans ma propre faille et descendre en moi-même ». Descendre pour atteindre le pardon, renouer le fil du temps, rouvrir les yeux, elle qui les a fermés depuis cette nuit d’horreur, entendre sa sœur murmurer, entendre l’appel des morts.
Oui Houris est long, trop parfois, mais il y a aussi du souffle dans cette écriture qui avance au galop, le sens de la formule et des images fortes. Un livre terrible, tragique et souvent insoutenable, non dénué d’humour et d’ironie aussi – voir la guerre entre le salon de coiffure et la mosquée, la femme de l’imam alpaguée par Aube, la petite qui prend Aube pour une journaliste, la folie d’Aissa ou le gynécologue… Pourtant, de manière paradoxale, Houris est un récit cathartique, il dit la nécessité d’une anamnèse, individuelle et collective, pour croire encore en l’espoir. Car « je crois que c’est lorsqu’elles gisent sans mots que nos histoires deviennent dangereuses ».
MH
Kamel Daoud, Houris, Gallimard 2024, 416 p., 23 €
