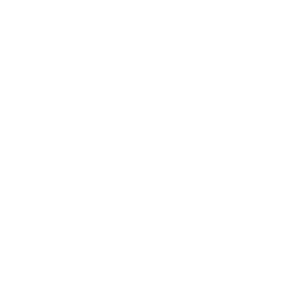L’histoire d’Idir avec l’ACB est une longue et belle histoire. Elle a commencé dès 1979 et s’est poursuivie sur près de quatre décennies. Au cours de ces années de travail, de mobilisations, d’échanges et d’amitiés, Idir a donné, en 1985, en 1999 et en 2007, aux magazines de l’ACB (Tiddukla d’abord puis Actualités et culture berbères) trois longs et importants entretiens. Ce sont ces entretiens que nous vous proposons de (re)lire pour (re)découvrir un homme d’engagements et de convictions.
2/3 – Les Identités d’Idir
Entretien donné par Idir à l’ACB en 1999
ACB. A quand le prochain album ?
IDIR.Il est prévu pour la rentrée et s’appellera Identités. Le but est de partager une chanson avec des gens de sensibilité différente, où chacun amène sa manière de voir les choses. Par exemple, je vais faire un titre avec Dan Ar Braz et Gilles Servat. Je vais chanter à ma manière et eux à leur façon : cela donnera une ambiance celtico-kabyle. Avec Kamel d’Alliance Ethnik, il va y avoir du rap. Le but c’est d’essayer, à partir des rythmes de chez nous, de lui faire dire des choses comme il les ressent parce que j’ai toujours la hantise de perdre l’âme originelle.
Êtes-vous influencé par les nouvelles formes d’expressions musicales ?
IDIR. Il y a des choses que j’aime, des choses que j’aime moins… Il est possible que l’on subisse des influences même inconsciemment. Ce qui est important, c’est de sentir qu’il y a une ouverture. C’est-à-dire au niveau de la musique, des possibilités de pouvoir étendre ses capacités d’expression. J’ai toujours la hantise de perdre de vue mon émotion première. Au lieu de parler de mixage ou de fusion, je parle plutôt d’interpénétration, une espèce d’osmose, où les choses entrent les unes dans les autres, au lieu d’un placage, d’un clivage où tu distingues nettement les deux styles ou les différentes composantes. Il faudrait arriver, de plus en plus, à moins distinguer les mélanges pour que cela forme quelque chose de plus entier. Je me dis toujours qu’il vaut mieux y aller comme ça. S’il y a une kabylité ou une algérianité en moi elles transparaîtront.
En 1977-1978 vous apportiez une innovation musicale dans la chanson, est-ce que le Idir de l’année 1999 est aussi porteur de nouveauté ?
IDIR. Dans cet album, ce qui me plaît c’est le côté stratégique de la chose, avant les chansons elles-mêmes. Je suis convaincu que j’ai toujours été un minoritaire. Je le suis encore parce que ma culture est oppressée et je tiens à mon identité, c’est tout à fait logique. Si j’arrive à partager cette identité avec d’autres identités, cela montrera pour moi et pour la culture que je représente qu’il y a une possibilité de s’inscrire dans l’universel. Quand les gens viennent partager cela avec toi, cela prouve aussi qu’il y a une forme de reconnaissance de leur part, et dans cette époque où ceux, parmi les plus proches de nous, ne nous reconnaissent pas, il est important d’aller chercher ailleurs, de dire que l’on existe malgré certains.
En quoi l’ouverture culturelle et linguistique qui est au centre de votre nouveau CD peut-elle trouver sa place dans le cadre de la tradition dont vous êtes aussi porteur ?
IDIR. Le besoin d’évoluer ou de partager une tradition n’empêche pas le respect de cette tradition parce qu’à côté de cela, je peux continuer à la travailler, lui donner plusieurs dimensions, plusieurs expressions, plusieurs facettes… L’un n’empêche pas l’autre. Dans cette dynamique, je ne vois pas pourquoi la musique kabyle ne s’inscrirait pas elle aussi dans l’universel. Mais on peut continuer à être soi-même, comprendre les autres et, éventuellement, partager des choses.
N’existe-t-il pas chez une partie de votre public – kabyle notamment – un risque d’incompréhension, voire de rejet ?
IDIR. C’est possible. C’est à eux d’apprécier la chose. S’ils ont envie de rester « kabylo-kabyles », eh bien, on restera entre nous, il n’y a aucun problème. On se regardera dans le blanc des yeux, on se dira qu’on est fort, qu’on est beau, qu’on est intelligent. Être kabyle c’est une chose, c’est bien mais ni pire ni meilleur qu’une autre. Mais être kabyle et apporter des choses à l’universel c’est mieux. Être les deux, c’est formidable. Maxime Leforestier vient chanter un couplet en kabyle en hommage à avril 1980, à Matoub Lounès, à notre conditionne trouve que cela devrait les relégitimer un petit peu dans leurs convictions et leur montrer comme une main tendue. Mais encore une fois, c’est à eux d’apprécier.
Vous avez signé chez Sony. Cela représente-t-il un tournant dans votre carrière ?
IDIR. Non parce qu’être dans une grande boîte, c’est bien, et là j’ai énormément de chance parce que les gens avec qui je travaille sont extrêmement motivés. Ils ne sont pas seulement sensibles à l’artiste mais aussi à la culture que je suis censé exprimer, ce qui est formidable pour moi parce que l’un ne va pas sans l’autre. Sans cette culture je ne suis rien. En fait, cela ne change qu’au niveau des moyens et de l’efficacité de la chose.
Ce qui n’est tout de même pas rien…
IDIR. Oui, bien sûr. Il y a d’ailleurs de nombreux contacts déjà pris, notamment avec la télévision… Mais ceci dit, je ne suis pas un fana de la télévision. Je veux faire des choses précises, ponctuelles, passer dans des émissions qui me ressemblent, il y a des choses que je ne saurais pas faire, où je ne saurais quoi dire ou comment me comporter. J’ai remarqué aussi que la télévision est une arme dangereuse. Si tu y passes souvent, n’importe comment, les gens finissent par se lasser et tu risques de disparaître. Je préfère le terrain du spectacle où tu es en face des gens. Un disque tu peux le rater, le réussir, mais les spectacles, cela te donne l’idée de ce qu’est un artiste, de ce qu’il représente et de ce qu’il chante.
Après le succès international du raï avec Khaled et Mami notamment, peut-on espérer demain une dynamique comparable pour la chanson kabyle ?
IDIR. Je ne sais pas… Succès international du raï, il faut le dire vite. Le raï n’est pas le reggae. Il y a un côté spectaculaire en France pour des raisons historiques, politiques, parce qu’il y a un lien entre ces deux pays, parce qu’il y a une forte immigration et aussi du fait de l’atmosphère politique ambiante (l’exclusion, le racisme…), on essaie d’ouvrir les portes à ces formes d’expression, c’est une chose. Cela donne un côté spectaculaire où effectivement, le raï s’inscrit dans la vie et dans la réalité française. C’est une musique qui est entrée dans des foyers français. Mais en dehors de la France, il y a soit des succès d’estime, soit des spectacles ou des demandes en raï, mais qui viennent en conséquence de ce qui se produit ici. Tandis qu’une musique forte comme le reggae s’implante partout, parce que c’est un mode d’expression qui a été codifié aussi bien en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, qu’en France. Il faut quand même faire la part des choses sans vouloir porter atteinte à la qualité des uns ou des autres. La musique kabyle, c’est autre chose. Tant qu’elle restera accrochée à une espèce d’identité obsessionnelle, je ne sais pas si elle va s’en sortir. Je n’aime pas les artistes qui veulent faire du kabyle avant d’exprimer leurs émotions artistiques propres. Je m’en désintéresse parce que ce qu’ils vont me donner, je le connais déjà. En revanche, l’évolution qu’ils pourraient porter avec eux m’intéresserait plus. Un gars comme Matoub, qui était vraiment quelqu’un que j’aimais et que j’aime pour plusieurs raisons, m’intéressait plus par son côté douloureux, personnel et intime que par son côté militant, où il dit à peu près la même chose que les autres dans une autre forme. Pour que cette musique kabyle puisse s’inscrire il faut qu’elle soit travaillée, il faut qu’elle soit émotionnellement très forte. Il ne faut pas qu’elle soit mimée ou copiée, je trouve qu’il y a énormément de chanteurs de chez nous qui se copient les uns les autres. Ce qui n’apporte absolument rien. Il y en a d’autres qui essayent d’ouvrir un peu cette musique, malheureusement ils tombent sur des placages où l’on reconnaît tel ou tel style occidental, ce qui ne me paraît pas très intéressant. Il y a ceux qui s’en tiennent à la préférence du texte sur la musique qui ne sert alors que de prétexte. Il faut changer l’oreille des jeunes et heureusement le raï justement apporte une idée positive. Il y a énormément de Kabyles qui sont ici en France, qui écoutent du raï ; le raï est entré dans les villages kabyles et pourtant c’est de la musique « arabe » ou arabophone qui, pour des raisons idéologiques, est censée ne pas intéresser. Heureusement, comme c’est agréable et que c’est bien fait, cela plaît. Quand une chanson est bonne, elle passe. Il faut se soucier de l’esthétique et de l’artistique. L’idéologie viendra après. Quand quelque chose est beau, attire, les gens se posent des questions sur toi, ta vie, ton environnement et pour moi c’est le moyen le plus efficace de proposer ta culture aux autres.
Votre album sort en automne, un concert est-il prévu à cette occasion ?
IDIR. Il y aura deux spectacles à l’Olympia prévus les 11 et 12 décembre prochains.
Ces concerts seront-ils à l’image du disque ?
IDIR. Oui dans la mesure où chaque soir, un ou deux invités, qui ont participé à l’enregistrement, viendront. Pour le reste, on donnera un spectacle où on essayera de construire un mélange d’ancien et de nouveau.
Des inédits ?
IDIR. Peut-être…
Vous parliez de Matoub Lounès, est-ce à dire qu’il laisse un vide, dans le monde artistique et revendicatif, qu’il sera difficile de remplacer ?
IDIR. Dans mon cœur il laisse un vide énorme. J’avais un faible pour lui artistiquement parce que c’était un véritable artiste. Lui et Dahmane El Harrachi m’ont vraiment impressionné par cette facilité à s’exprimer, par cette révolte permanente en eux. L’artiste n’est viable que parce qu’il est révolté, parce qu’il a un besoin, parce qu’il est malheureux et Matoub exprimait vraiment cette douleur et avec beaucoup de talent. Il laisse un vide, bien sûr. D’abord parce qu’il a été le porte-parole d’un certain style de chanson, direct, il appelait un chat un chat. Il laisse un vide parce qu’il était un des rares, et peut-être même l’unique, à pouvoir dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il laisse un vide parce qu’il exprimait vraiment la révolte de tous les jeunes, existentielle ou culturelle. Ce n’est pas demain la veille qu’on le remplacera. On peut faire autre chose, Matoub Lounès portait tout en lui : les germes de sa révolte, de ses besoins, de ses douleurs, de son génie artistique, il savait bien mélanger tout cela. Il y a des gens comme cela qui sortent du lot parce qu’ils ont su créer un univers bien à eux dans lequel ils savent attirer les autres.
Quel regard portez-vous sur les divisions qui traversent le mouvement culturel berbère ?
IDIR. Les gens aiment posséder quelque chose, être propriétaire, ils ont besoin d’expansion, d’espace, de rapports de force, de pouvoir… et je pense que c’est cela qui doit se passer. Mais qui trinque ? C’est la culture. Je me suis promis de ne pas tomber dans ces pièges parce que j’aime autant les uns que les autres. Même si je déclare mes affinités politiques ou mes tendances, je veux rester moi-même parce qu’un seul parti ne me suffit pas et que ma culture, je veux la rendre universelle. Alors, je me tiens autant que possible éloigné de ces divisions parce que d’abord, cette histoire de division ne m’intéresse pas : l’un a tort, l’autre a raison et alors, qu’est-ce que ça change ?
Comment l’artiste et le leader d’opinion que vous êtes réagit-il aux propositions de Salem Chaker qui en appelle à une autonomie linguistique et culturelle des régions berbérophones ?
IDIR. Est-ce possible, et comment éviter que cette forme de radicalisation ne débouche sur la violence ? Pour être possible, c’est possible ; maintenant, éviter l’écueil de la violence il est difficile aujourd’hui de conclure. Ce qui est évident, c’est que cette culture dans cet espace et aussi loin que l’on se souvienne, est l’une des premières. Il est donc tout à fait normal qu’elle soit non seulement reconnue, mais reconnue comme étant la culture première de cette terre. Quand on me dit qu’idéologiquement, l’arabe est la langue nationale et officielle et que l’on va se pencher sur les autres… je ne suis pas d’accord. J’ai mon identité propre et je sais que j’appartiens à une culture et à une civilisation qui sont là depuis la nuit des temps. Je n’ai pas à apporter la preuve de ma culture et de mon identité, c’est plutôt aux autres d’apporter la preuve de la leur. Chronologiquement, j’étais là le premier, s’il devait y avoir une première langue nationale rattachée à cette terre, à cet espace géographique, serait la mienne. Je n’en suis plus à revendiquer une permission d’exister. J’existe et je le sais en moi. C’est aux autres de m’apporter la preuve de leur existence et surtout de la vérité de leur identité. Si idéologiquement on n’arrive pas à s’entendre, il faudra savoir pourquoi et surtout faire la part des choses entre les gens du peuple, qu’ils soient arabophones ou berbérophones, et les systèmes politiques, qui eux, ont d’autres visées. Il faut faire très attention. Il faudrait organiser un référendum — réellement démocratique en ces temps de fraude — pour savoir si la culture berbère doit être reconnue comme nationale, officielle, constitutionnelle. Si j’étais convaincu que le reste des Algériens ne me reconnaissaient pas, alors je me poserais la question : « eh bien je n’ai rien à faire avec eux ? ». À ce moment-là, je chercherais les moyens d’être autonome et de me rapprocher des miens pour construire un autre projet de société parce qu’on ne veut pas de nous. Pour l’instant, je n’en suis pas encore convaincu. Il y a une histoire qui lie les Algériens dans leurs diversités. Soit cette histoire est viable et on vit ensemble dans le respect mutuel des cultures, soit il y a un clivage et l’idée d’une fédération peut peut-être apporter une solution.
Propos recueillis par Malika Sanaa
in Actualités et culture berbères, n°29, Eté 1999